Photo : Philippe Voghel-Robert
Durant l’été, notre collaborateur Mathieu Voghel-Robert a pris cinq semaines pour s’évader dans le bois. Avec ses deux frères, Philippe et Jean-Simon, il a traversé la portion québécoise du Sentier international des Appalaches (SIA) située entre Matapédia et Cap Gaspé. Munis de leur sac à dos et chaussés de leurs bottes, ils ont couvert plus de 640 km. Il nous livre des extraits de son carnet de voyage et partage quelques photos.
Une bête qui a du panache
On n’aurait voulu pour rien au monde manquer cette rencontre. L’accumulation d’indices, d’empreintes, de traces ne faisait qu’accroître le sentiment que, chaque jour, ce n’était que partie remise : crottes, pistes, bois, squelettes et broutage excessif. Philippe avait quelques mètres d’avance sur moi. La forêt était plutôt aérée et le temps, humide, et un épais brouillard concentrait notre univers dans un rayon de moins d’une centaine de mètres. Nous marchions depuis déjà quatre heures. Après un long silence, mon frère s’exclame avec beaucoup de conviction : « Hey ! Ça sent le parmesan en poudre ». Devant une telle déclaration, lancée avec autant de sérieux, j’ai pouffé de rire. Mon frère s’était retourné et justifiait sa déclaration assez mollement : « J’te le dis, ça sent le parmesan, le parmesan en poudre ». Pendant cette scène assez absurde en plein parc de la Gaspésie, j’ai couvert la distance qui me séparait de mon frère. Après avoir passé un arbre qui obstruait ma vue, j’ai levé la tête et c’est là que j’ai aperçu la bête : un gros mâle avec un panache de dix pointes se tenait tout juste à six mètres derrière Philippe. La présence d’une telle bête passe rarement inaperçue, surtout à une distance aussi courte, et il n’y avait donc aucune raison pour que mon frère ne l’ait pas vue. Pourtant, c’est comme si elle était apparue soudainement. Nous avons mis ça sur le compte de ses lunettes embuées. Bref, devant nous, un orignal magnifique nous observait tranquillement en broutant et, pendant tout le temps que nous avons mis à le photographier et à le contourner, il est resté imperturbable. Luc Sirois, professeur de biologie à l’Université du Québec à Rimouski, que nous avons croisé sur le mont Jacques-Cartier, nous a confirmé que l’odeur laissée par le mâle ressemble vaguement à celle du fromage.
Le Sentier international des Appalaches (SIA)

Il y a de ces jours où l’on décide d’aller se perdre dans les bois. Décision qui ne va pas sans danger, car, comme le dit Bilbon Sacquet à son neveu Frodon , « on prend la route et l’on ne sait jamais jusqu’où cela peut nous mener1 ». Nous avions donc pris nos précautions et le trajet choisi aboutissait au cap Gaspé, au bout du bout de la fin. Impossible de couvrir cette distance sans s’arrêter : le panneau au départ de Matapédia, à la frontière entre la Baie des Chaleurs, le Québec et le Nouveau-Brunswick, indique 639 kilomètres. Il faut compter six heures en voiture, mais la marche transforme ce périple en véritable défi. Dès le premier jour, nous avons droit à un orage tellement violent que la semaine suivante, le sentier est jonché d’arbres fraîchement tombés. Très vite, notre corps redécouvre des muscles dont nous ne soupçonnions pas l’existence et la plante de nos pieds entreprend tranquillement, mais douloureusement, sa transformation en cuir épais. Les bretelles du sac à dos creusent des plaies sur nos hanches. Les nuits sont courtes. Le corps récupère mal à être étendu sur des planches. Malgré tout, la routine s’installe. Chacun participe aux tâches et rumine sa douleur. Les kilomètres défilent et… là-bas, mais, c’est le fleuve ! Comme si nous avions traversé en coup de vent la vallée de la Matapédia et la réserve faunique de Matane avant de parcourir les crêtes des Chic-Chocs du parc de la Gaspésie ! En bas du mont Jacques-Cartier, le sentier bifurque vers Mont-Saint-Pierre pour ensuite longer le fleuve jusqu’à L’Anse-à-Valleau, petite baie précédant Rivière-au-Renard. C’est le début de la fin et la dernière longue étape sans ravitaillement avant d’entrer dans le parc Forillon et aboutir au cap Gaspé le long de la baie du même nom. On rentre, la tête pleine de souvenirs, le corps saturé d’acide lactique et les pieds recouverts de corne. Une fois arrivés au camping du Mont-Albert près de Sainte-Anne-des-Monts, nous avons appris que la portion du sentier que nous avons empruntée dans la vallée de la Matapédia était fermée depuis l’orage. « Ils viennent juste de le rouvrir », nous a annoncé notre mère. Tiens, tiens, les arbres dans le sentier, ce n’était donc pas normal. On en a passé jusqu’à une centaine par jour, et ça ne compte pas ceux qui étaient tombés hors du sentier.
Les chutes

S’il y a quatre endroits où vous devriez aller pour la beauté des lieux, ce serait là où il y a des chutes, mais pas n’importe lesquelles. Je ne saurais expliquer mon attirance pour les chutes et les cascades, mais ça sent le frais, en plus d’être aéré. Nous avons croisé le premier point d’intérêt dès le jour de départ : la chute à Picot, entre Saint-André-de-Restigouche et Matapédia. Une magnifique cascade en escalier qui coule sur plus d’une centaine de mètres. À peu près égales, les marches et les contremarches ne font pas plus d’une quinzaine de centimètres. Les remous provoqués par les roches donnent une impression d’avalanche continue. En plus, on peut s’y rendre en voiture et stationner à moins de deux kilomètres de marche de la chute.
L’autre endroit se trouve un peu au nord-est de Causapscal. Juste après le terrain de golf de la Vallée du Rêve, un pont enjambe la rivière Causapscal. Avant le pont, un chemin forestier longe la rive vers la gauche. Rapidement, il se transforme en un sentier bucolique menant au bas de cette magnifique rivière à saumon. Des cèdres gigantesques poussent en bouquet et s’étirent vers l’eau, prêts à y plonger. Au cours de la randonnée, l’eau, qui était d’un calme huileux, s’excite : les quelques remous se transforment en rapides. Le point d’intérêt se situe surtout à la chute à saumons où nous avons vu un monstre d’au moins un mètre et demi sauter pour remonter vers les frayères.
Si vous prenez la route 1 depuis Cap-Chat vers l’intérieur des terres, une quarantaine de minutes vous suffiront pour atteindre le stationnement du petit saut. Vous serez alors au cœur de ce que la réserve faunique de Matane a de plus beau à offrir. À l’ouest, un sentier grimpe vers le sommet du mont Nicol-Albert en longeant le gros ruisseau. C’est certainement le plus difficile que je n’aie jamais emprunté, mais également l’un des plus beaux. Le ruisseau n’est en fait qu’une succession de cascades déferlant dans un canyon et de chutes d’une dizaine de mètres. On en voit au moins une vingtaine au cours de l’ascension. Une fois en haut, la vue est grandiose : on découvre tous les sommets du parc de la Gaspésie, la sinueuse coulée de la rivière Cap-Chat et, bien sûr, le fleuve.
À moins d’un kilomètre du petit saut, un autre stationnement donne accès au sentier de la chute Hélène. Sans contredit mon coup de cœur de tout le périple, c’est un endroit paradisiaque. Une chute de 70 mètres se jette dans un bassin convenant parfaitement à la baignade. Le tout se trouve dans un petit cirque intime aéré par le mouvement d’air que provoque la chute. C’est seulement à quatre kilomètres du stationnement, mais si vous préférez une variante un peu plus luxueuse, l’Auberge de montagne des Chic-Chocs se trouve sur la crête de la montagne juste en face.
Solitude
Cela fait déjà trois heures que je marche. Philippe a pris de l’avance et Jean-Simon est parti après moi. Le rythme de mes pas ponctue mes pensées qui se perdent à la limite de la conscience. J’ai le visage fatigué, mais le regard vif, scrutant la forêt pour m’imprégner de chaque détail. Mon cerveau est ailleurs et l’écran de veille est tapissé de vert. De temps en temps, des éclairs de conscience jaillissent, excités par l’envol d’une famille de perdrix, le cri d’un tamia rayé ou le craquement d’un arbre. Autrement, mon esprit navigue en osmose avec les modulations de la forêt. L’endorphine résultant de l’effort physique soutenu et le manque de sommeil exacerbent les perceptions sensorielles. Même les repas se transforment en festin. Pour l’instant, je me sens seul au monde. Pourtant, mes frères sont peut-être à moins de cent mètres. La forêt est dense et le son ne voyage pas. Les seules traces que je vois sont celles d’orignaux passés par là plus tôt. D’ailleurs, le sentier semble être entretenu par des cervidés plutôt que par des sapiens. Dans tout notre voyage, nous n’avons croisé que 13 randonneurs qui ne faisaient pas une simple sortie d’un jour, dont seulement trois à l’extérieur du parc de la Gaspésie, haut lieu de la randonnée au Québec. Sur 640 km, ça fait une personne aux 50 km. Contrairement à Compostelle ou à d’autres sentiers de pèlerinage, le SIA en est un de solitude profonde. Nous sommes parfois cinq jours sans apercevoir la moindre trace de civilisation. Le murmure de la forêt est notre seul miroir, nos pensées notre seule conversation. Heureusement, nous socialisons quand nous arrivons au campement, et à l’heure du dîner et des collations. Les rencontres avec d’autres sont cocasses. Très peu de gens, y compris les locaux et les randonneurs occasionnels, connaissent l’existence du sentier. Une certaine incompréhension règne durant ces conversations, comme un choc des cultures. À la blague, Philippe appelle même les locaux « les indigènes ». Lorsque nous devons partager le campement ou le refuge avec d’autres, nous avons de la difficulté à soutenir une conversation intelligente, surtout passé sept heures. Notre cerveau est conditionné à errer en solitaire, son pèlerinage, en quelque sorte.
Géants et nains
Chaque rencontre avec un animal sauvage est un événement unique empreint d’excitation. Toutefois, le temps d’une montée d’adrénaline, il est relégué au rayon des souvenirs aussitôt la bête enfuie. Mais il y a des rencontres plus solennelles, plus posées et beaucoup plus longues. Cela prend parfois beaucoup de persévérance et un peu de chance. Tout comme les petits nobles qui rêvaient d’affranchissement et qui devaient patienter dans maints couloirs, boudoirs, salons, ou bureaux avant de rencontrer le roi. L’arbre, le mature, le souverain, celui qui cache la forêt et que la forêt cache. Par exemple, ces cèdres le long de la Causapscal, de la Sainte-Anne ou de la Cap-Chat. Les plus imposants frôlent le mètre de diamètre à hauteur d’homme. D’autres s’élèvent en spirale comme les colonnes torsadées d’un temple. Un autre, beaucoup moins massif, pousse à l’horizontale sur plus de deux mètres au haut d’une falaise avant de se redresser tranquillement vers le ciel. Il fait tout de même une dizaine de mètres. Ou encore, ces pins, trop rares, immenses miradors qui surplombent la mer de ligneux. Sans compter cette érablière, un peu avant Amqui. Le temps s’est arrêté comme lors de la visite d’une cathédrale : les troncs tiennent lieu de colonnes, les branches, d’arches, les feuilles, de voûte, l’humus et les couvres sols, de mosaïque. Ces arbres immenses, facilement bi-, voire tricentenaires, nous enveloppent d’humilité. Puis, ces géants nains, les krummholz, de l’allemand krumm, « tortueux » et holz, « bois ». Ces conifères poussent à la limite des arbres, soit à des latitudes nordiques ou des altitudes alpines. Certains ont plus de cent ans mais ne dépassent pas le mètre de hauteur. Mais le plus impressionnant, c’est ce bouleau jaune tout bosselé, à l’écorce déchiquetée, qui trône au pied d’une colonie de thé des bois. Rien n’égale la couleur gris-jaune-blanc-noir-brun de son papier luisant. Et que dire de ces mélèzes, ces peupliers, ces trembles, ces épinettes et ces sapins : Vos Majestés !
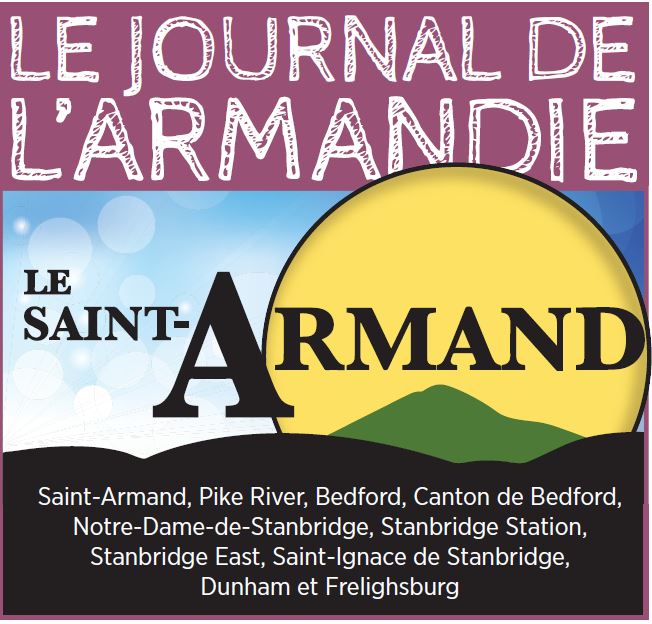
















Laisser un commentaire
Nous n’acceptons pas les commentaires anonymes et vous devez fournir une adresse de courriel valide pour publier un commentaire. Afin d’assumer notre responsabilité en tant qu’éditeurs, tous les commentaires sont modérés avant publication afin de nous assurer du respect de la nétiquette et ne pas laisser libre cours aux trolls. Cela pourrait donc prendre un certain temps avant que votre commentaire soit publié sur le site.