« Don Quichotte(s) et les moulins à vent », Parc Émilie Gamelin, Montréal (Québec), 27 avril 2012 (Photo : Marie-Hélène Parant)
Qu’on le veuille ou non, l’impasse de l’actuelle crise étudiante nous touche tous. Que ce soit dans les médias, entre amis, avec les voisins ou dans les soupers de famille, le sujet semble inévitable. Pourquoi ? Parce que ce qui n’était, au début, qu’un conflit entre les étudiants et le gouvernement, est devenu, aujourd’hui, un débat de société. De la question des frais de scolarité autour de laquelle s’opposaient carrés rouges et carrés verts, nous voici, après trois mois, avec les carrés blancs et les carrés noirs, les uns appelant à la trêve et les autres à la radicalisation du mouvement. Que penser de tout cela ? Et plus encore, que penser de tout ce qu’on raconte à ce sujet ? À ce point du conflit, peut-être faudrait-il reconnaître l’élément central de ces réactions qui fusent de toutes parts ? Je nomme ici la peur. Oui, la peur. En surface, il y a la peur que tout cela dégénère en grabuge, violence et répression. Une peur qui est d’ailleurs largement entretenue par les journaux à sensation et la télévision. À bien les écouter, il serait présentement « dangereux » d’aller à Montréal. Bien sûr, nous n’en sommes pas là, mais cette sourde peur du chaos est bien réelle. Et légitime. Possiblement parce qu’elle fait miroiter à la conscience que si ce conflit continue à se détériorer, tout le monde en paiera le prix. Je parle ici du mépris du gouvernement actuel envers sa propre population et des politiques répressives qu’il met en place pour soutenir ses discours d’austérité. Cependant, il existe également une autre peur, plus profonde et aussi bien plus sombre. Et plus problématique encore, parce qu’elle se traduit trop souvent par le silence. Il s’agit de la peur du désaccord, de la mésentente et du débat. Ainsi, celui qui hausse le ton devient menaçant, la discussion enflammée devient fissurée de rancunes et les groupes qui clament leurs revendications deviennent des « attroupements illégaux ». Peu importe comment on la qualifie, cette peur de l’Autre, de la différence ou de la discorde, déforme tout. Puis on finit par se méfier de personnes qu’on appréciait pourtant beaucoup. Et on refuse de discuter davantage.
Qu’y a-t-il de l’autre côté de la peur ? Des solutions ? Non, mais un dialogue. Et je ne parle pas seulement de celui qui devrait avoir lieu entre le gouvernement et les représentants étudiants, mais surtout de celui qui a lieu autour de la table, au téléphone, à la station-service, au coin de la rue… Ce dialogue auquel chacun participe, à chaque rencontre. Oui, parler de politique. C’est d’ailleurs l’une des grandes forces du mouvement étudiant que d’avoir ramené sur la place publique le devenir du Québec et ainsi, de nous obliger à le penser et à nous poser une double question : « Où trace-t-on la ligne de partage entre bien commun et charges individuelles ? Et que souhaite-t-on pour notre province, pour notre collectivité ? »
En ce qui me concerne, il y a longtemps déjà que je ne compte plus les manifestations auxquelles je participe, ni l’énergie que j’investis dans le mouvement étudiant. Pourquoi tout ça ? Les raisons sont nombreuses. Contre ceci. Pour cela. Sans refaire ici l’argumentaire avec lequel je défends et explique quotidiennement mon carré rouge, je tiens à rappeler que cet élan de contestation amorcé par des jeunes de partout au Québec n’est plus seulement l’affaire d’une génération, mais bien de l’ensemble de la société civile. Et si le mouvement étudiant fait du bruit au-delà des ponts de la métropole (et même de nos frontières), il le fait en soulevant des visions qui font émerger la force de croire et de vouloir un Québec qui n’a pas besoin de se fondre davantage dans le « modèle américain » pour se développer. La force de reprendre et de donner place aux programmes sociaux qui nous ont si bien servi et qui, à travers l’édification et le respect du bien commun, prennent autant soin de la société que de l’individu. Un projet amorcé il y a un peu plus de quarante ans. Et repris aujourd’hui, contre toute attente.
Un projet qui, aujourd’hui, nous divise. Cultivons l’attente que ce projet nous réunisse. À suivre.
*Christian Guay-Poliquin est un jeune Armandois qui s’est exilé à Montréal afin de poursuivre ses études.
Autres articles
Avez-vous lu?
- Les chaudrons de la colère
- Nouveaux revenus potentiels pour les municipalités rurales
- Amener la campagne à la ville
- L’agroforesterie missisquoienne
- Tali fait des bonhommes
- Les misères persistent à Dunham
- Des nouvelles de la société d’histoire et de patrimoine de Frelighsburg
- Richard Leclerc, candidat du parti québécois dans Brome-Missisquoi
- Bonne fête nationale à tous
- Les festivités de Pike River
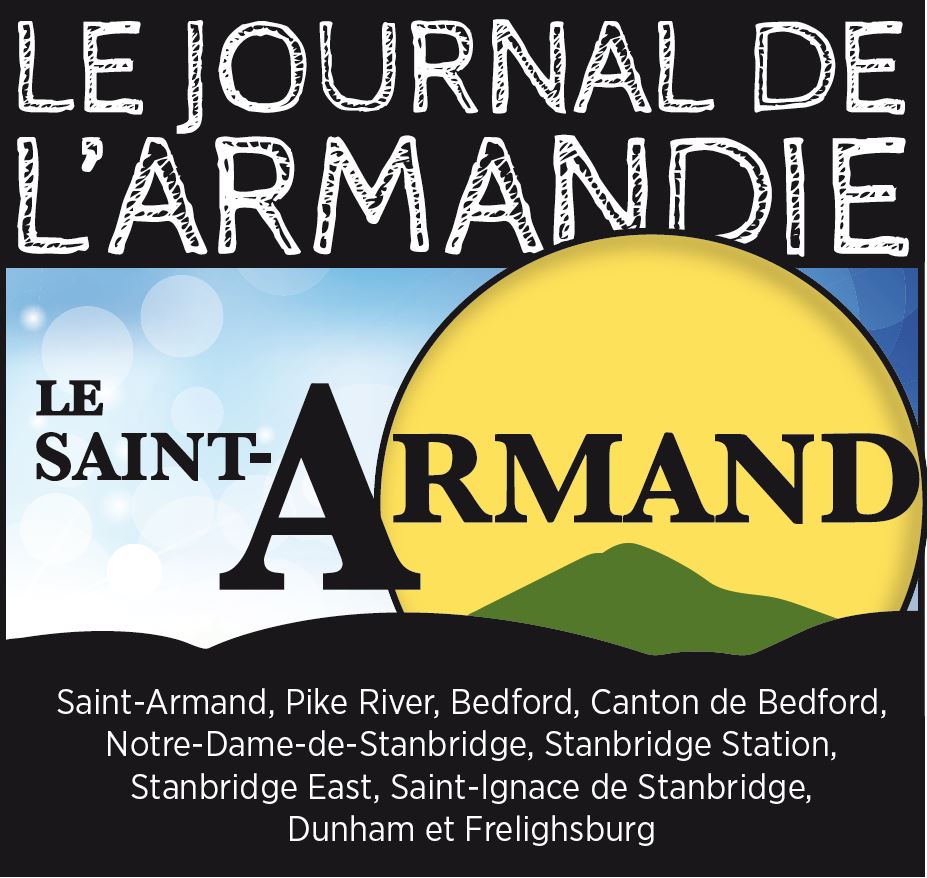
















Laisser un commentaire
Nous n’acceptons pas les commentaires anonymes et vous devez fournir une adresse de courriel valide pour publier un commentaire. Afin d’assumer notre responsabilité en tant qu’éditeurs, tous les commentaires sont modérés avant publication afin de nous assurer du respect de la nétiquette et ne pas laisser libre cours aux trolls. Cela pourrait donc prendre un certain temps avant que votre commentaire soit publié sur le site.