Geindre des injustices à coups de mots, espérant les atténuer, voilà ce qui motive l’écrivaine Pauline Gélinas. Celle qui vient de publier un conte mettant en scène Frelighsburg a répondu aux questions du journal Le Saint-Armand. Incursion dans l’univers d’une écrivaine installée depuis trois ans en Armandie…
« Une injustice jamais nommée, jamais montrée du doigt, se perpétue à jamais », dit-elle d’entrée de jeu. « Mais lorsqu’on est mille à la voir, puis à la dire, un mouvement de lutte contre cette injustice prend racine. » Les choses changent lentement dans une société, l’écrivaine le reconnaît. Elle soutient qu’on ne doit pas pour autant cesser d’espérer mieux.
 Originaire d’un tout petit « village ouvrier » de 800 habitants, qui a alimenté en hommes, et même en vies, une usine de papier journal en Mauricie, Pauline Gélinas dit avoir tiré de cet environnement la passion de lutter pour les démunis et contre les injustices sociales.
Originaire d’un tout petit « village ouvrier » de 800 habitants, qui a alimenté en hommes, et même en vies, une usine de papier journal en Mauricie, Pauline Gélinas dit avoir tiré de cet environnement la passion de lutter pour les démunis et contre les injustices sociales.
« La chair-à-usine que j’ai vue se briser sous mes yeux, dit-elle, m’a conduite à chercher des réponses aux écarts entre le petit cercle de riches et les marées humaines de pauvres. Très jeune, ma détermination a été de ne pas laisser la pauvreté me bâillonner. J’ai vendu des framboises des champs pour payer des cours de natation qui, eux, m’ont permis de m’asseoir sur une chaise de maître-nageur, ce qui m’a permis de payer ma place sur un banc d’université. »
 Ses études en science politique lui apprennent la manière dont se créent les écarts dans la société. « Écrire devenait une urgence, raconte-t-elle. Les mots de mon indignation surgissaient en image, comme des peintures. Pendant des années, ce sont des poèmes qui sortaient de ma plume. Un poème a un mouvement intérieur, un rythme qui apaise malgré les mots qui portent un cri déchirant. Chaque poème, je le vivais comme une obsession, et je ne parvenais pas à le lâcher tant que je ne l’avais pas amené en ce lieu où il devient beauté. Quand il atteignait ce stade, le poème avait rempli sa mission qui était d’apaiser mon indignation. »
Ses études en science politique lui apprennent la manière dont se créent les écarts dans la société. « Écrire devenait une urgence, raconte-t-elle. Les mots de mon indignation surgissaient en image, comme des peintures. Pendant des années, ce sont des poèmes qui sortaient de ma plume. Un poème a un mouvement intérieur, un rythme qui apaise malgré les mots qui portent un cri déchirant. Chaque poème, je le vivais comme une obsession, et je ne parvenais pas à le lâcher tant que je ne l’avais pas amené en ce lieu où il devient beauté. Quand il atteignait ce stade, le poème avait rempli sa mission qui était d’apaiser mon indignation. »
Ses poèmes prenaient alors tous le même chemin : un tiroir. À 28 ans, elle écrit son premier roman qui, lui aussi, passera un long moment dans un tiroir. « Écrire a toujours été mon mode de survie. J’en avais besoin comme de respirer. Soumettre mes textes à un éditeur était pour moi le péril le plus terrible qui se puisse imaginer. Je sentais, à cette époque, que si les maisons d’édition devaient rejeter mes mots, je cesserais d’écrire. Et cette idée m’était intolérable. Mes mots dans le tiroir me gardaient vivante. Me faire dire que je ne savais pas écrire m’aurait tuée. »
Ce n’est que 11 ans après l’écriture de ce roman qu’elle trouve le courage de l’envoyer aux maisons d’édition. Aujourd’hui, elle s’en veut d’avoir écouté ses peurs si longtemps, puisque ce premier écrit a été accueilli en grande pompe. Moins de 24 heures après ses livraisons dans 10 maisons d’édition de Montréal, un éditeur l’appelle pour publier son roman ! Trois mois plus tard, le roman intitulé Le Sexe sale entrait en librairie, et le critique du quotidien Le Devoir titrait : « roman d’une riche écriture ».
« Dans ce roman, j’ai voulu braquer les projecteurs sur le terrible vertige que vit toute adolescente dans l’apprentissage de sa sexualité. Elle arrive dans la cour d’école, chaque matin, avec la peur au ventre de se faire taxer de putain par celui qu’elle a autorisé, la veille, à lui toucher les seins. »
 Cette peur adolescente ne s’évanouit pas à l’âge adulte, soutient l’écrivaine. La majorité des femmes, dit-elle, continuent de mesurer dans l’œil de leur conjoint si, faisant tel ou tel geste, elles sont en train de franchir la limite où elles seront vues comme une putain. « Des femmes m’ont écrit avoir pleuré en lisant ce roman, revivant leur adolescence. Certaines m’ont dit que ce roman mettait des mots sur ce qu’elles n’avaient jamais réussi à exprimer. »
Cette peur adolescente ne s’évanouit pas à l’âge adulte, soutient l’écrivaine. La majorité des femmes, dit-elle, continuent de mesurer dans l’œil de leur conjoint si, faisant tel ou tel geste, elles sont en train de franchir la limite où elles seront vues comme une putain. « Des femmes m’ont écrit avoir pleuré en lisant ce roman, revivant leur adolescence. Certaines m’ont dit que ce roman mettait des mots sur ce qu’elles n’avaient jamais réussi à exprimer. »
Après quelques années comme journaliste à la radio de Radio-Canada, Pauline Gélinas retourne à l’université. Lors d’un stage à l’ACDI dans le cadre sa maîtrise en science politique, elle fait une découverte qui la renverse. « Mes recherches m’ont fait voir un lien de « parenté » qui m’a bouleversée : le Québec de mes parents des années 1940-1950 et la bande de Gaza des réfugiés palestiniens des années 2000, tous deux enfermés dans une même quête démente : la force du nombre. C’est dans la bande de Gaza qu’on enregistre la plus grande concentration de population du monde. Le taux de chômage avoisine les 80 %. L’aide internationale diminue chaque année réduisant la possibilité de nourrir les enfants. Et, malgré cela, le taux de natalité y est le plus élevé du monde. J’étais jetée à terre. Je revoyais mes parents se faire haranguer par le curé du haut de sa chaire pour qu’ils continuent de faire des enfants, bien qu’incapables de les nourrir. »
En prévision d’une enquête terrain pour sa maîtrise, elle ramasse ses sous pendant un an, puis part dans les camps de réfugiés de Gaza. Microphone en main, l’ancienne journaliste quête des réponses à la question qui la hante : pourquoi faire tant d’enfants qu’on ne peut nourrir ?
« Avant de répondre à mes questions, les réfugiés me passaient un interrogatoire. Je leur racontais d’où je venais : de la force du nombre, moi aussi, celle qui devait battre les anglophones et les protestants. Après, ils acceptaient de me parler à cœur ouvert des raisons de leur force du nombre à eux. »
L’écrivaine dit avoir fait à Gaza le plus beau voyage de sa vie, malgré un ciel constamment traversé de chasseurs de l’armée israélienne. « Jour après jour, j’entrais dans les cuisines des réfugiés. J’ai même été reçue par le tribunal du clan de Gaza. Un jour, alors que j’étais avec un groupe de femmes dans une pièce inondée d’enfants, je demande à l’une d’elles pourquoi elle en a eu 13. Elle me répond en désignant le bambin sur ses genoux : “parce que c’est mon premier garçon”. Je peux vous dire qu’une telle phrase dans l’oreille d’une femme explose en mille poignards à l’intérieur. Les 12 naissances d’avant n’étaient que des coups d’épée dans l’eau, qui enfonçaient davantage la famille dans la pauvreté. Et la pauvreté de ses 12 filles nées “en attendant” se mirait dans la pauvreté des 9 enfants de mes parents. »
Le soir, à son hôtel, l’écrivaine couchait sur le papier les faits marquants de ses entretiens du jour, dans une forme de récit littéraire. À son retour, en octobre 2002, le récit intitulé La force du nombre était presque terminé. Le printemps suivant, en 2003, une maison d’édition accepte de le publier. L’écrivaine se lance ensuite dans la rédaction de son mémoire de maîtrise. Cela complété, elle retourne au journalisme. Devenue rédactrice en chef du Journal du Barreau, elle écrit, en parallèle, des nouvelles littéraires, qu’elle publie en 2012 et qu’elle présente dans les bibliothèques publiques. « Ma préférée reste la nouvelle qui porte le titre du recueil : Ma grand-mère s’appelait Monsieur. C’était la première fois que je parvenais à écrire dans un genre comique sur un phénomène que je trouve absurde. Mon personnage de la petite Marthe m’a permis de le peindre à coups de fous rires. »
Lorsqu’une maison d’édition scolaire lui propose d’écrire des manuels de politiques et d’histoires pour les élèves du secondaire, l’écrivaine voit dans ce travail fait à la maison la possibilité de retourner vivre en région, dans un petit village. Et le plus grand des hasards la mène à Frelighsburg, un nom qu’elle n’avait alors encore jamais entendu !
Peu de temps après s’y être établie, elle fait une rencontre qui la transporte dans un nouvel univers littéraire, le conte. Elle s’associe avec l’illustratrice Marie-Claude Lord pour produire Le secret du grand A volant, l’histoire vraie de l’héritage qu’un enfant de Frelighsburg a laissé dans sa communauté peu avant de mourir, il y a de cela 18 ans, et dont le journal Le Saint-Armand a fait écho au moment de son lancement l’automne dernier.
Son tout dernier projet d’écriture l’entraîne maintenant dans l’univers de la fauconnerie. Ce projet, explique-t-elle, exigeait une vaste recherche, mais surtout de vivre l’expérience de mon héroïne. L’écrivaine a donc passé une partie de l’été 2013 avec des fauconniers travaillant en entreprise.
Deux ans plus tôt, elle avait entendu à la radio une entrevue qui l’avait jetée à terre. « Le maître-fauconnier de l’aéroport Dorval-Trudeau décrivait son travail. Je découvrais une des relations les plus fascinantes qui se puisse : imaginez, une relation d’entraide et de besoin mutuel basé sur la trahison de l’un et la menace constante
d’une rupture de la part de l’autre. Une relation faite d’extrêmes inconciliables, et pourtant si efficaces ! Pendant deux ans, j’ai cherché une piste pour explorer cette relation si exceptionnelle du mélange confiance-trahison, puis l’hiver dernier, le déclic s’est fait. J’ai trouvé le personnage central pour incarner ce sujet et sa trajectoire. J’ai aussitôt appelé ce maître-fauconnier. Emballé par la trame de mon projet de roman, il m’a ouvert les portes de son univers avec les buses et les faucons. »
L’ancienne journaliste s’est alors mise à lire sur les oiseaux de proie pour arriver bien préparer sur les sites de travail des fauconniers. « Le maître-fauconnier et ses fauconnières ont tous été d’une générosité incroyable. Ce n’était pas uniquement sur leur technique de travail que je les interrogeais, mais aussi leurs échecs, les difficultés, les drames qu’ils ont vécus. J’ai récolté des récits bouleversants. Et vous savez, les faucons ne sont pas domestiqués. Ils restent sauvages. Chaque fois que le fauconnier lâche son oiseau de proie, il ne sait jamais s’il reviendra. C’est chaque fois un déchirement, et il doit gagner la confiance du rapace, tout en le trahissant constamment. »
Ce n’est pas le seul univers que l’écrivaine a documenté avant d’amorcer l’écriture. Elle a aussi dû convaincre une institution « très fermée », précise-t-elle, de faire incursion dans son monde. Là aussi, des portes se sont ouvertes. L’écrivaine trouve ce travail de recherche des plus stimulants. « Vous savez, bien des gens croient que l’écriture d’un roman ne se fait qu’avec l’imagination. Ça peut être vrai lorsque le récit est collé directement à notre propre histoire. Mais dès qu’on traite d’un environnement dans lequel on n’a pas vécu, on doit s’astreindre à des recherches méticuleuses. Si on n’a pas les informations nécessaires pour créer un cadre vraisemblable, les lecteurs le sentent et laissent tomber le livre. »
Les gens qu’elle interviewe sont souvent étonnés du genre de questions qu’elle pose dit-elle. « J’ai besoin, en quelque sorte, d’entrer en eux, de ressentir leurs émotions, et de me l’approprier. Ensuite, l’émotion macère jusqu’à ce que je lui trouve la bonne couleur. Quand cela arrive, les mots jaillissent en flots. Chaque jour a son flot qui permet quelques pages. »
L’écrivaine passera les prochains mois dans une certaine réclusion au bras de sa nouvelle héroïne ; et avec l’aide de faucons, elle explorera de nouveaux visages de l’injustice.
Autres articles
Avez-vous lu?
- Ce que je sais de toi
- Croc Fendu
- Les yeux grands ouverts
- Femme forêt
- Une leçon d’histoire qui nous concerne
- Écriture, vérités et conséquences
- Autoportrait d’un paysan rebelle, une histoire de pommes, de vin et de crottin
- L’amour à l’aube des fins du monde
- La Terre vue du cœur
- À la recherche de la bléphilie de Dunham
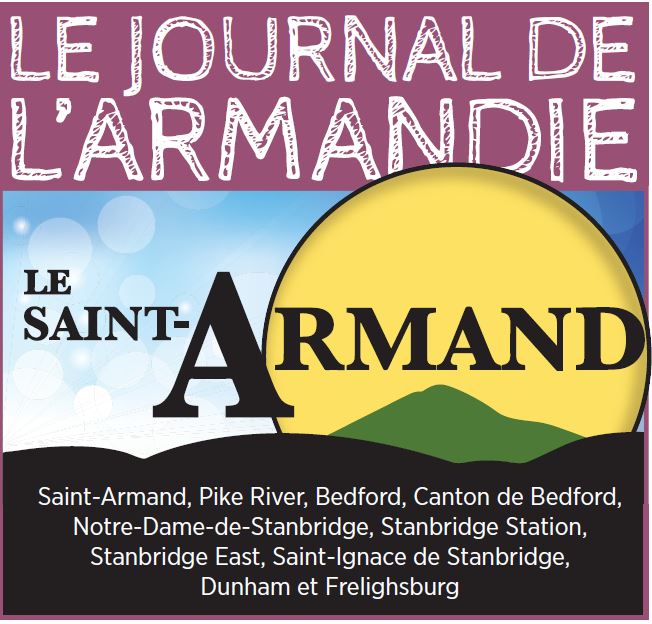
















Laisser un commentaire
Nous n’acceptons pas les commentaires anonymes et vous devez fournir une adresse de courriel valide pour publier un commentaire. Afin d’assumer notre responsabilité en tant qu’éditeurs, tous les commentaires sont modérés avant publication afin de nous assurer du respect de la nétiquette et ne pas laisser libre cours aux trolls. Cela pourrait donc prendre un certain temps avant que votre commentaire soit publié sur le site.