photo : Nathalia Guerrero Vélez
Née à Brasília en 1992, Taís da Costa a douze ans quand son père, un ingénieur œuvrant au sein de l’armée, est embauché par l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) dont le siège social est à Montréal. Père, mère, fille et garçon débarquent donc au Québec en 2004. Installés dans le quartier Côte-des-neiges, les parents décident d’envoyer leur fille à l’école anglophone où l’adolescente qu’elle est se sent tout de suite rejetée car elle ne parle que le portugais. Pourtant, elle en avait rêvé de cette installation au Canada. Elle se rabat sur ses amies brésiliennes, avec qui elle communique par Internet sur une base quotidienne. Pendant deux ou trois ans, elle mène donc une existence de recluse, repliée sur elle-même et sur son mal du pays. Puis, arrive Maïa qui, malgré son jeune âge, la prend sous son aile protectrice. Une sorte de marraine avec qui elle est bien et avec qui elle se remet à l’anglais — qu’elle avait appris très jeune lors d’un séjour aux États-Unis, puis oublié. Les barrières tombent, elle se fait des amis et a désormais une vie sociale normale.
 Son parcours scolaire est celui d’une artiste : beaux-arts à Dawson College, bac en arts visuels à l’université Concordia, puis dessin graphique, métier qu’elle exerce présentement en tant que pigiste. Sites Web, logos, cartes, rapports, affiches, notamment celles que la ville de Lac-Brome a installées devant ses divers bâtiments historiques et municipaux (le graphisme, pas le support précise-t-elle), elle fait de tout.
Son parcours scolaire est celui d’une artiste : beaux-arts à Dawson College, bac en arts visuels à l’université Concordia, puis dessin graphique, métier qu’elle exerce présentement en tant que pigiste. Sites Web, logos, cartes, rapports, affiches, notamment celles que la ville de Lac-Brome a installées devant ses divers bâtiments historiques et municipaux (le graphisme, pas le support précise-t-elle), elle fait de tout.
Entre ses études et sa situation actuelle, il y a eu toutefois une longue période où elle a travaillé comme serveuse dans divers restaurants de Montréal. C’est d’ailleurs dans l’un d’eux qu’elle a rencontré son copain Daniel Likoray, qui exerçait le métier de cuisinier depuis ses quatorze ans.
Suite à une offre d’emploi à Bromont, puis à Dunham, le jeune couple décide de s’installer dans la région et part en quête d’une propriété. Sur un site d’offre immobilière, ils découvrent la perle rare. Rare oui, mais perle, non, selon leur agente immobilière, qui leur déconseille de l’acheter, voire même de la visiter, au motif que la maison n’a ni style ni cachet et qu’elle est sur le marché depuis plus d’un an. Ils décident tout de même de visiter l’endroit et le trouvent tout à fait à leur goût : la maison leur convient, le terrain a les dimensions requises pour Mario le chien, la contiguïté de la rivière Yamaska Sud-Est qui le borde et la proximité des services les enchantent. C’était en 2019, juste avant la pandémie. Depuis, les deux jeunes gens ne cessent de se féliciter d’avoir pris la décision de quitter la ville pour s’installer dans ce coin de campagne pour le moins pittoresque.
L’artiste qui habite Taís da Costa insistant pour qu’elle élargisse ses activités créatives, elle s’inscrit, en 2020, à un cours de céramique et aux ateliers libres offerts par Michel Viala et Sara Mills de la Poterie Pluriel-Singulier de Saint-Armand. Artisane assidue, elle y a depuis ses habitudes et ses quartiers, à preuve cette motte d’argile emballée dans du plastique et reposant sur une tablette qui porte son nom, attendant la transformation par les mains et le feu.
Il ne semble plus rien rester de sa morosité adolescente sinon, peut-être, une certaine retenue qu’elle porte avec un naturel qui lui va comme un gant. Elle se dit heureuse à la campagne, mais déplore la relative homogénéité de la population et de l’offre alimentaire. Au moins, elle peut compter sur les talents culinaires de Daniel pour varier le menu. Déjà qu’il s’est mis à la cuisine indienne que, paraît-il, il prépare avec brio.
Hors entrevue, nous nous retrouvons sur la petite plage de galets qui borde la propriété de Tais et de Daniel, nous discutons de sujets pêle-mêle —des arbres qui risquent de tomber, des pannes électriques qui, à la campagne, nous laissent sans eau, mais aussi de leur bonheur quand l’électricité lâche et qu’il faut cuisiner dehors sur un feu de bois, de la famille de canards élargie (deux mamans, un papa et cinq petits) qui fréquente les eaux de la rivière, de la profondeur de celle-ci, etc. Tais s’enthousiasme pour tout ce qu’elle découvre à la campagne, mais elle s’indigne aussi : du prix aberrant des logements, des inégalités sociales, du déni patent des injustices par les autorités, de la situation terrible des migrants. C’est indéniable : j’ai affaire à une jeune femme avertie, impliquée, active et déterminée à améliorer, sinon changer, le monde.
Il fait chaud. Je regarde avec envie Tais qui, chaussée de sandales en plastique, se rafraîchit les pieds dans l’eau tout en devisant des maux et lumières de l’humanité.
Mario, le chien
Il y a quelques années, Tais et Daniel, qui souhaitaient adopter un chien, ont découvert à leur grand regret qu’il n’y en avait plus à adopter au Québec tellement la demande était forte depuis le début de la pandémie. Difficile aussi de le faire aux États-Unis et en Ontario. Ils se sont donc tournés vers Rescue Dogs Lebanon-Canada*, un organisme qui accueille les chiens errants ou maltraités au Liban et les offre en adoption à des Canadiens désireux de s’en procurer un. C’est ainsi que, après moult tests, vaccinations, installation d’une micropuce et paperasse, Mario s’est rendu au Canada en avion avec vingt autres de ses semblables, dont sa sœur. Tais et Daniel se disent heureux de leur démarche, compte tenu particulièrement du fait que le Canada a récemment annoncé qu’il interdirait l’adoption au pays de tous les chiens venant de pays où le risque de rage est élevé, ce qui est le cas du Liban. Cette annonce résulte d’un incident unique s’étant produit dans un proche passé au cours duquel deux personnes munies de faux papiers ont fait entrer au pays des chiens infectés par la rage. Indignation de la jeune femme qui croit qu’il y a de nombreux autres moyens de contrer le problème que l’interdiction absolue, laquelle s’apparente à la bombe qu’on emploie pour tuer une mouche.
* https://www.rescuedogslebanoncanada.org
Autres articles
Avez-vous lu?
- Le périlleux parcours de Leret Fataki
- Anton Uvarov
- L’immigration, c’est l’affaire de tous !
- Nathalia Guerrero Velez, dans l’humanitaire jusqu’au bout des ongles
- Augusto Betti, ou découvrir le monde en passant par le Québec
- Cathie Sombret : vingt ans à défendre la cause des femmes du Québec
- Du Togo à Bedford, QC
- Anton Uvarov
- Le périlleux parcours de Leret Fataki
- Oriana Familiar
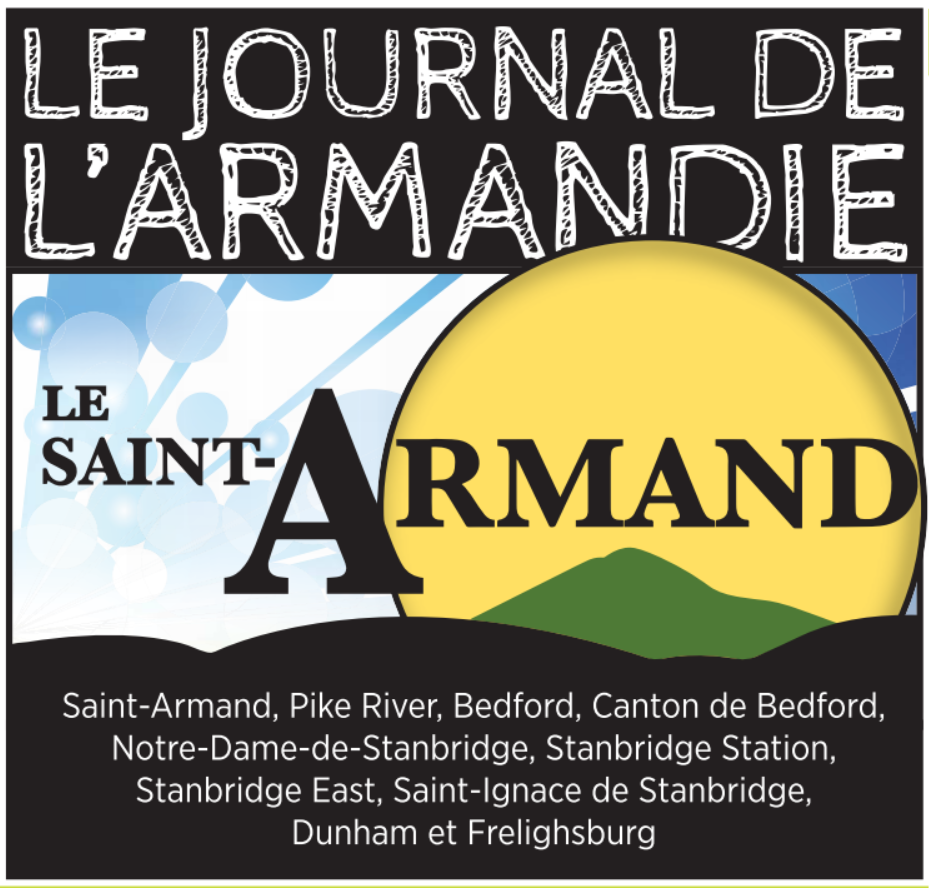




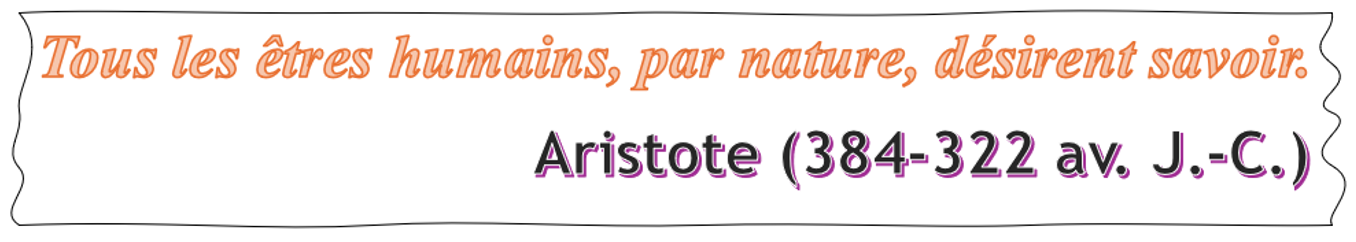


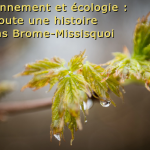







Laisser un commentaire
Nous n’acceptons pas les commentaires anonymes et vous devez fournir une adresse de courriel valide pour publier un commentaire. Afin d’assumer notre responsabilité en tant qu’éditeurs, tous les commentaires sont modérés avant publication afin de nous assurer du respect de la nétiquette et ne pas laisser libre cours aux trolls. Cela pourrait donc prendre un certain temps avant que votre commentaire soit publié sur le site.