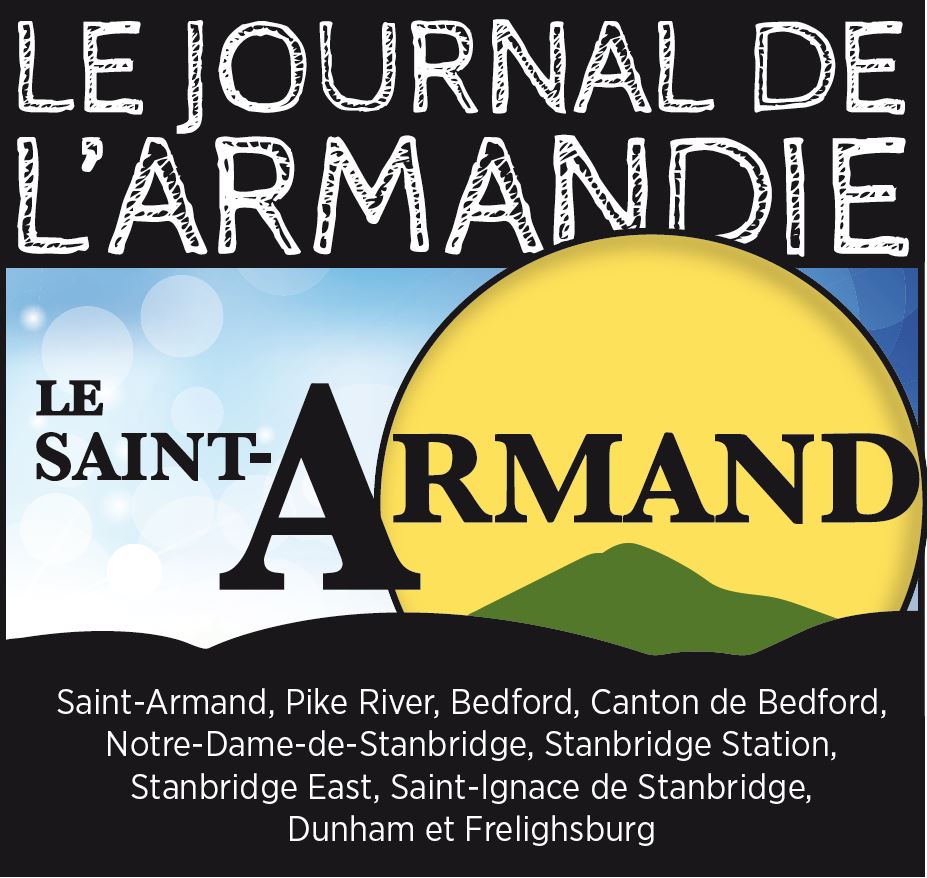Illustration : Johanne Ratté
Jean-Yves Dionne est pharmacien. Il a fondé l’Académie de l’Apothicaire, une organisation qui produit et diffuse de la formation continue aux professionnels de la santé en matière de produits de santé naturels et d’approches thérapeutiques dites « non conventionnelles ». Il travaille également (en collaboration avec des Armandois) à la préparation d’une série de livres numériques grand public, « Ma santé entre mes mains », qui s’adresse à celui qu’il nomme « le nouveau patient ». Il tient le blogue « Franchement Santé » à l’adresse suivante : www.jydionne.com.
La médecine fondée sur les preuves invalide-t-elle les thérapeutiques naturelles ?
Les études cliniques ont d’abord été conçues pour l’étude des molécules pharmaceutiques. Elles sont très utiles, mais ne conviennent pas forcément à des approches comme la nutrition. Il est vrai que, de manière générale, la qualité de la preuve, pour bien des thérapeutiques « naturelles », n’est pas encore à la hauteur de celle que présentent les grandes pharmaceutiques pour leurs médicaments de synthèse. La raison en est bien simple : mener des essais cliniques d’une telle envergure exige un investissement qui n’est justifiable que pour une substance brevetable, qui peut rapporter gros au détenteur du brevet. À l’inverse, un produit de santé naturel ne peut généralement pas être protégé par un brevet et, en conséquence, ne rapportera jamais autant à son fabricant, même si son emploi clinique s’avère utile. Alors, on mène moins d’études et les résultats probants tardent à venir. Non pas parce que le produit est inefficace, mais parce que ce n’est pas assez payant. Malgré tout, les thérapeutiques naturelles ayant fait l’objet d’études ont, dans bien des cas, donné des résultats probants. Cependant, ce serait une erreur de croire que seules ces dernières présentent un intérêt pour la santé. On pourrait comparer cela au fait d’écouter les prévisions météorologiques à la radio ou à la télé plutôt que de mettre le nez dehors ou de regarder par la fenêtre pour savoir quel temps il fait. Il arrive souvent que l’expérience de terrain des praticiens de la santé rende mieux compte de la réalité que les résultats d’essais cliniques publiés dans les revues spécialisées.
La pratique médicale tombe souvent dans le piège des querelles de clocher, comme le faisait autrefois l’orthodoxie religieuse, qui accusait d’hérésie tous ceux qui déviaient de ses préceptes. Il faut sortir de ce modèle d’opposition stérile et voir la réalité telle qu’elle est. Si une chose est vraie, elle le reste même si le dogme prétend l’inverse.
Vous dites souvent aux professionnels de la santé que « le nouveau patient est arrivé ».
Qu’entendez-vous par là ?
Le patient d’aujourd’hui a accès à de l’information ; il veut comprendre les choses et décider par lui-même des moyens à prendre pour rester en santé. Par conséquent, le praticien doit pouvoir s’adapter à la personne qui le consulte. D’un point de vue légal, le médecin est un simple conseiller, et il appartient au patient de décider si un traitement lui convient. Cependant, la formation que nous recevons en tant que professionnels de la santé est en contradiction avec cette réalité. On nous enseigne à nous situer en experts et à considérer ceux qui souffrent comme des ignorants n’ayant aucune idée des moyens à prendre pour s’en sortir. Il est donc difficile de se retrouver face à un patient qui dit : « Je ne veux pas de ton ordonnance. Je veux connaître les raisons qui ont motivé ton conseil et je prendrai moi-même ma décision ». Nous n’avons tout simplement pas été formés dans cette perspective. On ne nous a pas appris que nous étions au service des patients ; on nous a plutôt amenés à croire que nous étions la crème de la société et qu’il était de notre devoir de soigner ces gens « qui ne savent pas ». C’est en quelque sorte un détournement de la motivation qui anime la grande majorité de ceux qui ont choisi, en toute bonne foi, de devenir professionnels de la santé : aider son prochain, faire don de soi. Quand je vois les médecins spécialistes se féliciter des augmentations d’honoraires considérables qu’ils ont obtenues et qui ont conduit à l’instauration de la Contribution santé, quand je constate que l’on a mis en chantier trois centres hospitaliers universitaires dans une ville qui n’en mériterait qu’un seul, je me dis qu’on construit des cathédrales pour permettre aux archevêques d’y trôner alors qu’on étrangle littéralement le véritable praticien de la médecine, qui travaille humblement dans sa petite chapelle.
Je constate qu’il y a actuellement, chez les professionnels de la santé, un intérêt croissant pour les approches moins orthodoxes. Et il m’apparaît clair que cet intérêt vient de la pression du public. En parallèle, on assiste à une multiplication des études portant sur ces thérapeutiques, ainsi qu’à une amélioration remarquable de la qualité de la preuve démontrant leur utilité clinique.
Croyez-vous qu’il y a place pour des approches de ce type dans une coopérative de santé ?
Très certainement. Ne perdons pas de vue qu’une coopérative naît de la volonté d’une communauté donnée de se prendre en mains et de se donner les services de santé qui lui conviennent, qu’ils soient couverts ou non par la Régie de l’assurance maladie. Je crois même que c’est la voie de l’avenir : intégrer à la pratique médicale des services d’information et de prévention qui, au bout du compte, permettront de diminuer la facture totale d’un système de santé qui nous coûte beaucoup trop cher.