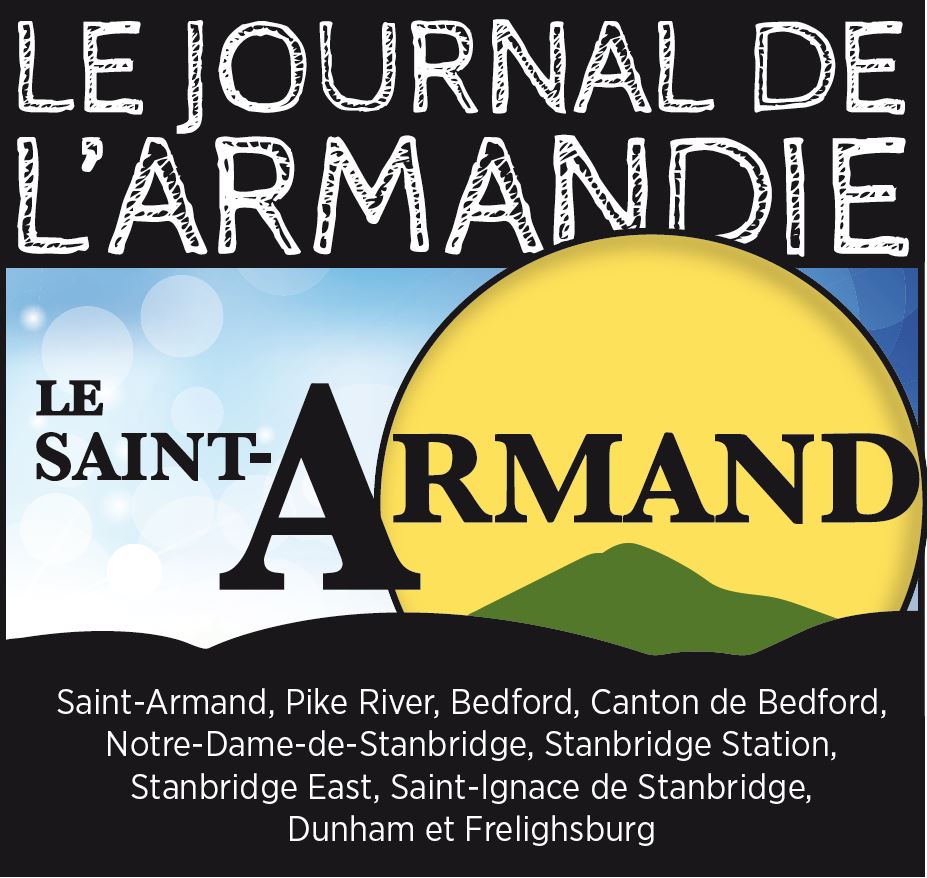Micheline Lanctot (photo : Bernard Carrière)
Le 20 octobre dernier, dans le contexte de la tempête médiatique que suscitait la vague de dénonciations d’agressions sexuelles qui secouait le Québec, Micheline Lanctôt était invitée à l’émission radiophonique Plus on est de fous, plus on lit, diffusée sur la Première chaîne de la société Radio-Canada. À cette occasion, la célèbre réalisatrice, originaire de Frelighsburg, livrait un formidable texte qu’elle a généreusement consenti à offrir au journal Le Saint-Armand.
Au risque de décevoir, je ne commenterai pas le cœur des révélations des dernières semaines, ça ne sera une surprise pour personne que j’affiche #moiaussi. Toutefois, ce dont j’aimerais parler n’est pas étranger au sujet qui fait les manchettes.
Dans ma famille, on ne parlait pas. On racontait des histoires. Les anecdotes ne manquaient pas, et je détiens un vaste répertoire de récits dans lequel j’ai abondamment puisé pour raconter mes propres histoires. Mais nous ne nous sommes jamais véritablement parlé. Ni véritablement compris. Je me suis réfugiée dans l’introversion, moi qui étais d’un naturel plutôt enjoué. Petite, j’ai essayé d’apprendre à parler à travers les dialogues des livres que je lisais et qui me semblaient, eux, être porteurs de sens. Je remercie la littérature, elle aura été mon apprentissage et ma rédemption !
Mais voilà je suis un QI non-verbal.
Donc, j’ai étudié la musique pendant 12 ans, car c’était le seul moyen pour moi d’exprimer ma façon de réagir au monde. Je suis une lyrique. Les mots me sont toujours apparus relatifs au regard des expressions qui les sous-tendent. Il a d’ailleurs été démontré depuis longtemps par les théoriciens de la communication que les mots ne comptent que pour 30 % de la communication ; 70 % des messages que nous échangeons sont de l’ordre du non-verbal.
Je lutte donc avec les mots depuis toujours. Lorsque je parle ou que j’écris, je suis brutale. Je ne sais pas m’amuser avec la parole ni jongler avec le verbe. Je suis toujours convaincue de n’être pas comprise, pas tout à fait, pas comme je voudrais. Je vis, hélas, dans un dessin animé : lorsque j’écoute quelqu’un parler, ce qui me parvient aux oreilles est le plus souvent une bouillie sonore, un arrière-plan mélodique à ce que je lis sur le visage de mon interlocuteur et qui me paraît toujours contenir davantage de sens que ses paroles. Attention, menteurs !
Les supercheries verbales ne me leurrent pas. Ce ne sont pas les mots que je décode. Ce sont les airs, les gestes, les intonations, les mines, les tics, les regards, les couleurs de vêtements, les réactions thermiques, les odeurs… Les mondanités sont pour moi un parcours du combattant : j’y perds rapidement pied, envahie par les messages qui me parviennent de tous bords tous côtés, étourdie par l’incessant et incompréhensible bourdonnement des voix.
Devant un visage inexpressif, je panique, je suis tétanisée, incapable de saisir à qui j’ai affaire. J’espérais m’améliorer avec l’âge, mais mon QI reste obstinément non-verbal. J’ai épousé un Français, ce qui peut paraître paradoxal ! Il a été mon université de la conversation. Tout, chez les Français, passe par l’expression orale, et la convivialité est une vertu cardinale. Mon mari montait dans un taxi et parlait au chauffeur. À l’aéroport et à bord de l’avion, il parlait aux agents de bord et au pilote. À l’arrivée, il parlait aux agents de l’immigration, aux policiers, aux passagers, aux agents de location de voitures. Il parlait aux gens qui attendaient aux caisses, aux employés de magasin, au Marocain de la petite épicerie du coin. Il trouvait les Québécois taciturnes et lointains. Il me trouvait sauvage. À son contact, j’ai apprivoisé l’art de la conversation. J’ai appris à dire : « Bonjour m’sieurs dames », en entrant, et « Au revoir m’sieurs dames », en sortant. J’ai fait quelques progrès, même si le non-verbal des Français me paraissait parfois si intense que j’en perdais mes moyens. J’ai appris, difficilement, l’art de la répartie, mais je n’ai jamais réussi à produire les mots d’esprit et les vannes dont mon mari possédait l’admirable secret.
On m’a souvent reproché, ou envié, c’est selon, une franchise parfois décapante. Mais voilà, les mots me trahissent. Les nuances se perdent, non pas faute de vocabulaire, mais faute de maîtriser l’agencement sémantique et, surtout, de lui faire confiance. Je perds patience et ça sort en vrac, sans finesse, sans filtre. Je le dis comme je le pense, sans y mettre les formes dont d’autres, plus exercés que moi, maîtrisent la façon.
Dans la collection des TED, j’ai eu l’occasion de voir et d’entendre Boris Cyrulnik. À mesure qu’il parlait, il me semblait tout comprendre : son langage était clair, précis, articulé, signifiant. C’était donc possible ? Il y avait moyen de parler pour se comprendre ? Idem de Noam Chomsky, dans le film qui a fait date, Manufacturing Consent, dont les idées les plus complexes s’expriment dans une parole si claire qu’elle nous fait sentir intelligents.
À quoi peut bien tenir ce miracle ? Que les mots que ces deux hommes prononcent, et les idées qu’ils expriment, me semblent à moi si limpides. Serait-ce que leur 70 % et leur 30 % fonctionnent à l’unisson ? Chomski est un linguiste révolutionnaire. Normal qu’il maîtrise la communication orale. Cyrulnik, neurologue et psychiatre, connaît le poids des mots et les choisit toujours avec circonspection. Mais, surtout, ce sont des êtres de raison qui sont en parfaite adéquation avec ce qu’ils entendent communiquer. Les regarder, les écouter, c’est les entendre penser. C’est avoir la révélation qu’une parole peut être fiable et vraie, et qu’on peut en construire une communication authentique.
On est loin du vacarme insignifiant et anonyme des réseaux sociaux, des formules toutes faites des politiciens, des babillages mondains et de l’émotion à tout prix des infos en continu. Ou du vocabulaire frelaté de la langue de bois et de l’écorchage du franglais. Nous vivons dans un monde contaminé par les émotions et qui carbure aux sensations. Or, dans les deux cas, la communication est brouillée et offre au mensonge un terreau fertile. Il n’y a qu’à voir les points de presse de la Maison Blanche.
J’ai beaucoup réfléchi à ces deux maîtres, en cherchant à comprendre ce talent très particulier qu’ils partagent et qui se fait de plus en plus rare : le parler vrai. A quoi cela tient-il ? De quel domaine du langage cela ressort-il ? La syntaxe ? La rhétorique ? La sémantique ? Qu’y a-t-il dans l’agencement sujet-verbe-complément qui éclaire à la fois le message et son destinataire ?
Le parler vrai n’a rien à voir avec « dire les vraies affaires », qui relève du spin de relationniste. Le parler vrai suppose une pensée qui, comme l’écrivait Boileau, « se conçoit clairement et les mots pour le dire nous viennent aisément ». Il faut donc réapprendre à penser. Ce n’est pas chose facile dans une société de l’instantané où tout va de plus en plus vite. Mais il me semble que réfléchir est devenu une question de survie. « Connaître est préférable à ressentir » disait le grand cinéaste Roberto Rossellini, comment autrement parviendra-t-on à comprendre le monde infiniment complexe dans lequel nous vivons ? Si certains hommes réfléchissaient avant d’agir, ils comprendraient sans doute ces « non ! » que les femmes répètent, sans réussir à se faire entendre.
1220 mots (aucune illustration fournie)