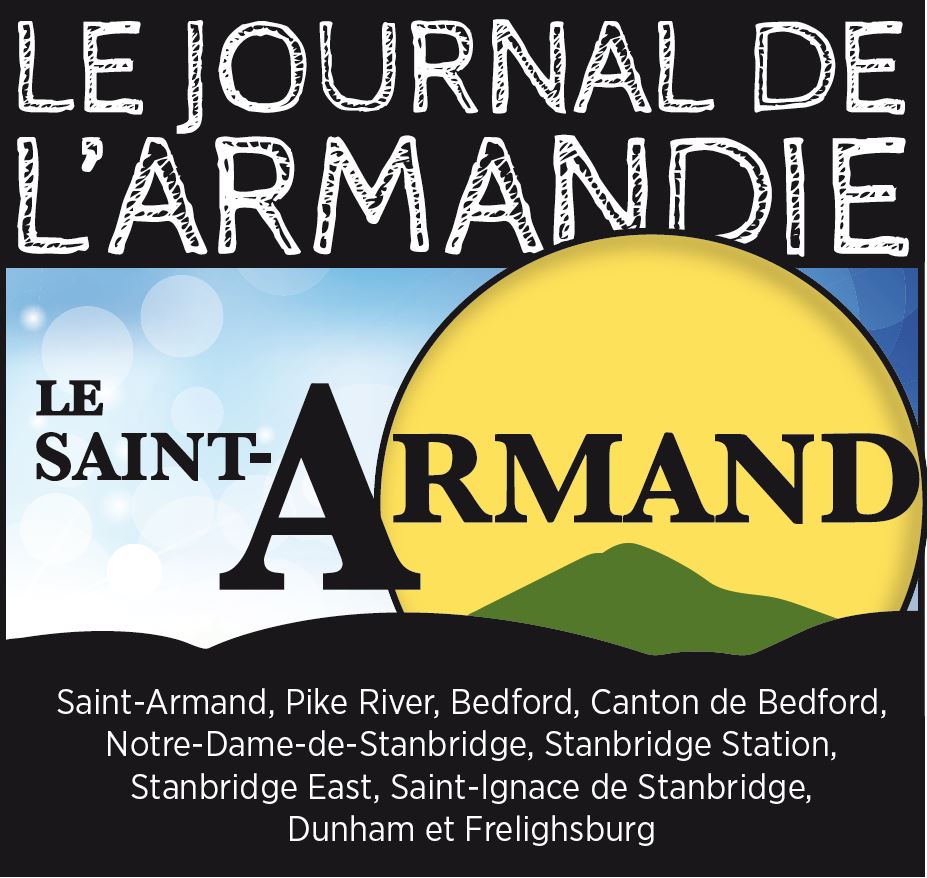X 12 Gaspard ; Photo : Michel Lambert
Dès le moment où l’on met le pied chez Nancy Retallack-Lambert, à Pigeon Hill (Saint-Armand), on sait qu’on entre dans la maison d’une artiste (de deux en fait, puisque son époux, Michel Lambert, a été designer avant de devenir organisateur d’expositions internationales pour la ville de Montréal). L’art est là, tout autour mais sans ostentation. Comme un effleurement sur la peau, un enveloppement discret de l’être, impression étrange et fugace qui m’a habitée tout au long de l’entrevue. Il y a les œuvres de sa mère, Evelyn Barton-Retallack, artiste peintre dont le nom figure d’ailleurs dans A Dictionary of Canadian Artists publié en 1996 et qui, de toute évidence, a transmis son talent à sa fille, celles d’ami-e-s, le fauteuil en bois fabriqué par l’arrière-grand-père à partir d’un kit, un coussin recouvert d’un splendide patchwork repésentant un motif classique de la géométrie islamique posé dessus sans souci d’ordre, des vitraux suspendus au milieu de la pièce créant une fausse impression de division tout en y exaltant la lumière, puis une bibliothèque remplie de livres d’art qui, pour l’heure, cohabitent avec un tamia, invité indésirable dont il faudra pourtant bien se débarrasser un jour.

Dessin, peinture, sculpture, gravure, photographie, Nancy Retallack-Lambert s’intéresse à toutes ces disciplines avec une prédilection, toutefois, pour la gravure sur bois et l’eau-forte, d’où le fait qu’elle se qualifie d’estampière généraliste. Elle fait essentiellement de l’édition de gravures et des livres d’art (une centaine à ce jour), qu’elle réalise à partir de photographies et qui, achevés, sont déposés aux Archives nationales du Québec. Parmi eux X 12 Gaspard, livre accordéon comprenant douze représentations touchantes du petit-fils qui, laissé à lui-même sur une plage, expérimente et s’amuse avec une paille rouge. En filigrane, l’humour, que l’artiste dispense dans plusieurs de ses œuvres, comme ce grand dessin à la plume d’une paire de chaussures sur lequel de vrais lacets ont été ajoutés. Ça vous étonne et vous plante un sourire sur le visage.
Si elle s’est tournée vers l’enseignement, par nécessité autant que par intérêt, elle n’a jamais cessé pour autant de produire et a participé au fil des ans à une foule d’événements, biennales, triennales, expositions en solo ou à plusieurs. Depuis qu’elle est à la retraite, elle se consacre à temps plein à son art. « J’ai eu la chance, confie-t-elle, d’étudier la gravure aux côtés d’Albert Dumouchel qui m’a fait acheter tous les instruments nécessaires à cet art. Si je devais me les procurer aujourd’hui, il faudrait que j’aille carrément à Paris ; ils sont introuvables ici, ou alors, en ligne, mais à gros prix. » Dans l’atelier, j’aurai d’ailleurs droit à un mini cours en accéléré d’eau-forte : transfert d’une image sur une plaque de cuivre, gravure à l’aide d’un burin ou d’une pointe sèche, puis immersion plus ou moins longue dans un bain d’acide, selon l’effet recherché.
À noter tout particulièrement, sa série portant sur les oiseaux meurtris par des déchets de plastique traînant sur les plages, l’avant et l’après, l’avant, quand le vol était parfaitement assuré et le cou bien dressé, l’après, quand le plastique a fait ses ravages et que le corps se démantèle. Thème qui peut sembler morbide, mais l’exécution est tellement riche, tellement achevée qu’on ne peut s’empêcher de voir, au-delà du tourment, la perfection d’une forme conçue pour des créatures dont la vocation est de voler.
Enfin, en primeur dans Le Saint-Armand ( !), une illustration des cinq portes sur lesquelles l’artiste a travaillé tout un été sans discontinuer afin de leur donner une seconde vie – gravure en noir sur blanc d’un côté et en blanc sur noir de l’autre. Toujours en attente de leur destination – ou destinée – finale, elles se retrouveront peut-être un jour accrochées aux cimaises d’une galerie branchée de la métropole ou d’ailleurs.

Photos : Michel Lambert
Tout au long de l’entrevue, Nancy Lambert égrène ses propos de noms d’artistes, qui professeur, qui ami, qui connaissance, dont plusieurs me sont inconnus mais qui ont laissé leur marque sur le paysage québécois, voire à l’étranger. Outre Alfred Dumouchel, les Alfred Pinsky, Yves Gaucher, Monique Charbonneau de ce monde. Des noms d’écrivains aussi, notamment celui de Wallace Stevens, dont le célèbre poème Thirteen ways of looking at a blackbird lui a inspiré la série de gravures Thirteen ways to look at a match (treize manières de regarder une allumette), celui de Léandre Bergeron également, auprès duquel elle a étudié la littérature canadienne-française durant tout un été, et d’autres dont le souvenir m’échappe. Il faut dire que le discours est rapide, enflammé, elle a tellement de choses à dire et nous avons si peu de temps. Ce sont des décennies vécues dans la plus grande effervescence que l’on doit faire entrer de force dans deux petites heures d’une entrevue qui sera interrompue pour cause d’autres obligations. Et dans un texte de 850 mots qui en mériterait bien plus.
C’est ainsi qu’il nous faut passer sur les décorations au pochoir que l’arrière-grand-père a réalisées à la basilique Notre-Dame, sur Van Gogh et la découverte d’une autre peinture, sur Mimi, grande collectionneuse d’art, qui la pousse vers l’école des Beaux-Arts, où elle restera finalement cinq ans, sur Urte, l’amie allemande absolument nulle à l’école, mais artiste mur à mur, sur la décoration des vitrines du célèbre magasin Morgan de la rue Sainte-Catherine, sur sa rencontre avec la Société des Faux-Visages et les masques rituels des Iroquois, autant de récits qui mériteraient qu’on s’y arrête longuement.
… et pédagogue de l’art
À l’issue de ses études aux Beaux-Arts et d’une année à étudier la gravure, Nancy Retallack occupera quelques emplois précaires avant d’être embauchée par la désormais défunte base militaire de Saint-Hubert pour y enseigner l’art aux enfants, tous niveaux scolaires confondus. Éprouvant toutefois une impression d’inachevé, elle s’inscrira au programme de pédagogie de l’art à l’université Concordia et fera du style artistique chez les enfants le sujet de sa thèse de doctorat. « On n’avait jamais étudié ça auparavant, explique-t-elle. On ne connaissait que les trois stades dits graphiques – le gribouillage, le schématisme et le postschématisme – faciles à identifier et qui sont associés au dessin. Mais les enfants font beaucoup plus que du dessin. Ils font aussi du modelage, du collage. Il y a toute une partie du développement artistique qui consiste en un contact sensoriel avec la matière. » Dans le cadre de son doctorat, elle suivra un groupe d’enfants durant cinq ans et prendra alors la mesure de la richesse et de l’importance de leurs capacités artistiques.
Enseigner l’art d’enseigner l’art
Par la suite, elle consacrera trente ans de son existence à initier les futurs enseignants inscrits à la formation des maîtres de l’Université de Montréal à l’enseignement de l’art. Nous sommes à l’époque où cette formation, autrefois confiée aux religieuses dans les Écoles normales, passait aux mains des universités. En quête de professeurs dûment patentés et ouverts aux nouvelles idées, les autorités de l’université demandent à la jeune professeure qu’elle est déjà à Concordia de se joindre à leur équipe.
« Ce fut une période magnifique, confie-t-elle. À la quatrième année de la formation des maîtres, les étudiants pouvaient choisir le projet pédagogique de leur choix et tous optaient pour les arts. D’où le fait qu’on soit venu me chercher pour cause de manque de prof. Durant cette époque formidable, la création multidisciplinaire était à l’honneur : musique, marionnettes, théâtre, arts visuels, danse, toutes les disciplines s’entrelaçaient harmonieusement. »
Pendant toutes ces années où elle occupera un petit bureau au 5e étage de la vénérable institution, sa principale préoccupation sera d’apprendre aux futurs enseignants à libérer l’art, et son enseignement, de l’héritage des religieux, pour qui collage, bricolage et dextérité fine en constituaient l’essentiel et qui ne laissaient guère de place à la création. À faire la différence entre art et bricolage. Non pas qu’elle méprise ce dernier, simplement « que les enfants possèdent en eux tout ce qu’il faut de créativité pour produire de l’art authentique, personnel, intuitif et que cela ne se résume pas à découper et à colorier. » Ce qu’elle laisse entendre en filigrane, sans s’en indigner outre mesure, c’est que la majorité, sinon tous les futurs enseignants ignorent à peu près tout de l’art, n’y ayant jamais été initiés eux-mêmes et qu’il n’est donc pas étonnant que leurs connaissances soient limitées dans ce domaine. D’où le fait qu’elle aura souvent recours aux masques, costumes, marionnettes et autres « artifices » dans le but d’aider ses étudiants à renouer avec leurs jeunes années, à parachever « une enfance incomplète », dit-elle, une enfance privée d’art.
Un regard critique sur le marché de l’art au Québec
Ou plutôt sur son absence. Autre constat douloureux pour cette artiste qui a participé à un nombre impressionnant d’expositions en solo ou à plusieurs, de biennales, de triennales et j’en passe : « On ne peut pas vivre de son art au Québec », les exceptions confirmant la règle en quelque sorte. Bien sûr, les Riopelle se vendent bien, de même que les œuvres de quelques autres géants, mais pour l’artiste peu connu ou inconnu, les chances de se faire une place sont minimes. Peut le confirmer son fils, galeriste de son état. À quoi attribuer cette situation ? Selon l’artiste, au fait que la classe moyenne n’investit pas dans l’art. Elle ne blâme pas, mais constate. Tant que la classe moyenne n’investira pas, le marché restera inexistant. On pourrait discuter longtemps des raisons profondes de cette désaffection de la population envers les arts visuels, alors que la musique, l’humour, le cinéma et les téléséries ont le vent dans les voiles. Est-ce un effet rebond de cette absence dans les écoles dont il a été question précédemment ? Est-ce parce que les arts visuels sont moins accessibles que les autres formes artistiques ? Est-ce parce que, dans l’esprit de la plupart des gens, l’art est un investissement réservé aux plus riches qui s’enrichiront davantage quand ils revendront les œuvres ou c’est quelque chose qui a sa place dans les musées, pas dans les maisons ?
« Tu ne dois jamais te dire, conclue celle qui affirme sans ambages que l’art, c’est sa vie, que tu vas gagner ta vie avec ton art. Il faut juste que tu trouves d’autres manières de la gagner. »
Au moment où je m’apprête à partir, elle me confie, presque en catimini tellement le rêve est grand mais l’espoir, mince, qu’un de ses grands souhaits serait de mettre sur pied, avec d’autres artistes et artisans, un lieu culturel du genre galerie/boutique/café où les clients, amateurs d’art et curieux seraient accueillis dans un décor propice à faire découvrir et aimer l’art, et à en discuter, voire à le critiquer au besoin. Un lieu où les yeux se décillent et où l’esprit s’ouvre à l’enchantement.
L’art rend meilleur
Les propos de Nancy Retallack-Lambert sur l’enseignement de l’art résonnent avec plus d’acuité encore à la lecture de cet énoncé publié sur le site de Réseau réussite Montréal* :
Les élèves qui participent à des activités artistiques ont plus de chances de réussir : ils ont de meilleurs résultats scolaires, sont moins susceptibles de décrocher et deviennent des citoyens plus engagés.
*Organisme regroupant 33 partenaires régionaux de tous les milieux qui désirent contribuer à la persévérance et à la réussite scolaires des jeunes
https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/arts-et-perseverance-scolaire/