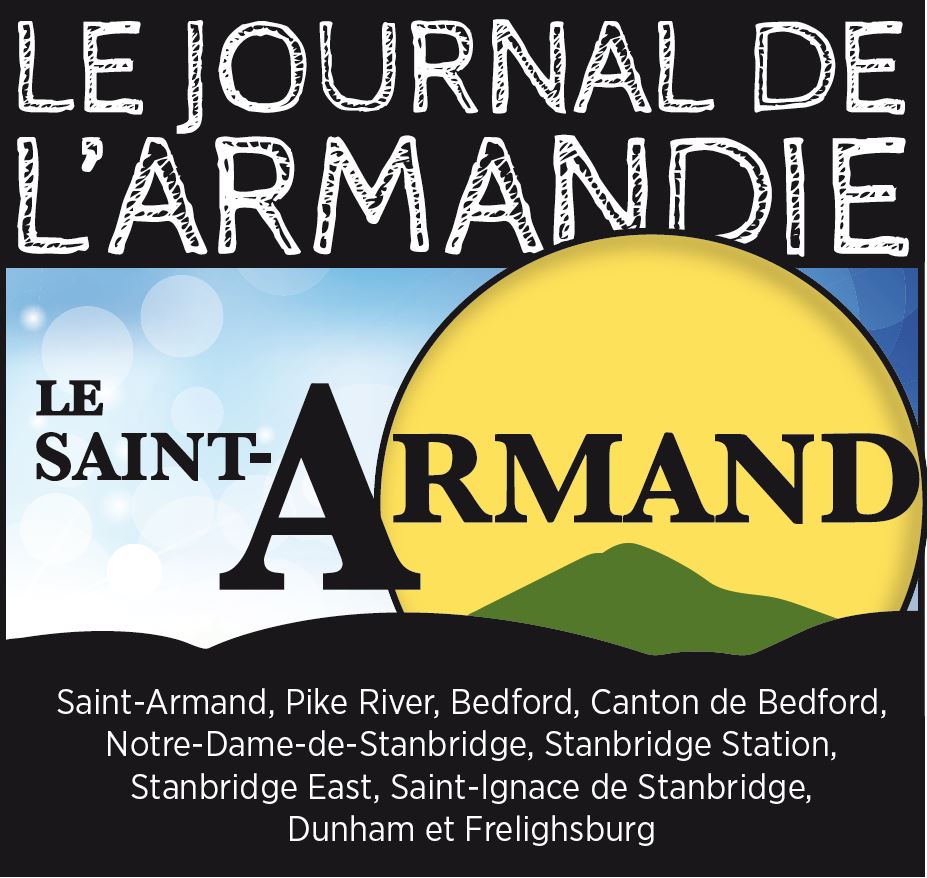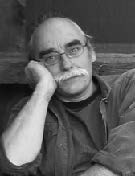Michel Louis Viala (Photo : Sara Mills)
« Montpellier ! » répond avec une fierté audible le grand gaillard aux bacchantes grisonnantes à ma question – vous venez d’où ? Je suis curieuse, je veux tout savoir. Et votre nom ? Il vient d’où ?
« Viala, c’est un nom comme Tremblay ici. Ah oui ! Y en a des Viala, Vialais, Vialette etc., en Occitanie. Ça viendrait du fait que les Romains y ont installé des villas romaines. Villas, Viala… A Montpellier, des Michel Viala c’est pas ce qui manque ! ! C’est pour ça que j’ai ajouté Louis. Parce que mon grand-père s’appelait Louis et que des Michel Louis Viala c’est pas mal plus rare. »
Dès qu’on parle de ses origines, l’accent du Sud perce dans la voix, rocailleuse, chantante, tonitruante parfois, origine méridionale oblige. Je lui demande alors s’il parle occitan.
« La langue d’oc, langue de bas latin, a ses écrivains, ses poètes, ses troubadours. Je m’y suis sensibilisé car, dans la bibliothèque de ma grand-mère, il y avait de nombreux ouvrages dans cette langue. Chez ces gens du terroir, la littérature de culture occitane était vivante, mais à leur époque, centralisme oblige, on n’avait pas le droit d’enseigner la langue d’oc… J’étais à Montpellier au mois de mars dernier, dans une librairie, j’ai vu qu’il y avait un département occitan. J’ai parcouru les ouvrages de littérature, de poésie ; pour moi, l’occitan parents. J’étais là depuis dix minutes lorsque, dans mon dos, j’entends parler occitan, je comprends ce qui se dit et je me rends compte que ça me rejoint, je me retourne et je vois deux jeunes hommes dans la trentaine qui continuent de converser en occitan !Cette image m’a fait prendre conscience de la nouvelle modernité de cette langue. »
On digresse assez longtemps sur le contexte politique dans lequel on a repris l’enseignement de la langue d’oc, le même que celui de l’enseignement du basque ou du breton. Ce phénomène de régionalisation, qui est advenu en France au cours des quinze dernières années, sans doute afin de contrer les mouvements autonomistes un peu trop radicaux. Et sur le caractère identitaire de la langue. Ce qui amène bien vite la question suivante.
Pourquoi le Québec ?
« C’est un projet qui m’a amené au Québec. J’avais un atelier à Paris, puis j’ai fait le saut Paris-Pigeon Hill, la marche était haute !
En fait, j’ai été conquis, j’avais pris contact avec des céramistes d’ici ; une fois retourné en France dans mon atelier minuscule, ils m’ont demandé de revenir au Québec pour monter un atelier à plusieurs. Je suis venu en me disant, ça va me servir, je vais faire mes premières armes, je vais apprendre comment on fait, puis quand je retournerai en France, j’irai en province, vraisemblablement dans le Languedoc, de là je serai plus à même de voir comment développer une production de céramique à plusieurs.
Je suis arrivé ici et j’ai eu une chance extraordinaire, j’ai rencontré des gens qui savaient tout faire. Alors qu’en bons Européens, nous on est plutôt spécialisés. Je n’ai pas été élevé dans la pratique du pionnier, moi… ! ! »
C’est un pur méridional, mais Michel a grandi à Paris, où ses parents étaient montés après la guerre pour trouver du travail.
« L’opportunité de m’installer est tombée, je suis venu ici et effectivement, j’ai appris (il cite Raymond Devos) qu’avec rien on fait rien mais qu’avec trois fois rien on fait quelque chose…
Je suis très chanceux de ne pas avoir fait ça tout seul (il indique son magnifique atelier, ses trois fours à cuisson, son terrain parsemé de sculptures en tous genres, les siennes et celles de sa conjointe, Sara Mills), parce que je reconnais que tout seul, je serais probablement retourné à Paris. La transition était trop grande…
Ici la qualité de vie qu’on se fait est quand même assez merveilleuse. J’ai pu le mesurer en voyageant en Europe, c’est devenu extrêmement pénible là-bas de faire ce métier-là. Alors je me considère comme vraiment chanceux d’être ici. »
Je lui demande s’il ressent l’appel des racines occitanes, s’il retournerait en France pour y finir ses jours, comme ses parents sont retournés dans le Midi après quarante ans à Paris.
« Non ! Non ! Parce que, notamment au niveau politique, c’est pas à mon goût du tout. »
Je lui fais valoir que le contexte culturel est quand même plus développé en France, que les artisans y sont quand même installés depuis plus longtemps, davantage valorisés, que l’activité culturelle y est mieux structurée.
« Quand j’étais artisan en France, j’avais un statut, qui valait ce qu’il valait, mais au moins j’étais respecté en tant que tel. En Amérique du Nord, c’est beaucoup plus compliqué. J’ai le sentiment que la culture et ses acteurs ne sont pas suffisamment considérés et que l’on a tendance à confondre divertissement et culture. »
Je lui parle du régime britannique, de la British Labour Law, qui détermine le régime du copyright au Canada et qui stipule que l’auteur de l’œuvre est celui qui en a la propriété. Si contraire à l’esprit français.
Nous parlons ensuite du Compagnonnage français et de son système d’apprentissage.
« Au niveau artistique, on peut se servir de la céramique pour aller plus loin, bien plus loin au niveau créatif, mais les jeunes sortent d’une école où on leur a appris à faire des objets design qu’on peut reproduire à la chaîne, c’est vraiment dommage. À Montréal on manque de galeries où exposer les pièces de recherche ou les pièces d’expression. On aimerait qu’il y ait des espaces où ça éclate, qu’on ouvre de nouvelles possibilités. »
Nous sommes tout à fait d’accord sur le fait que d’aller « se faire voir ailleurs » permet de s’améliorer, de situer ce qu’on fait, de découvrir de nouvelles idées, de voir et de montrer ce qui se fait à l’extérieur de chez soi.
« Nous avons une chance extraordinaire, Sara et moi, de vivre de notre métier. On vient juste de faire l’exposition à Mystic, et j’ai discuté avec des artisans céramistes ; ce sont des nomades. Installés la plupart du temps dans les grandes villes, ces céramistes sont obligés de se trimbaler d’une expo à l’autre… Nous on a décidé, ça fait plus de dix ans : moins on va se balader mieux ça va être ; par contre, on va faire venir les gens à l’atelier. C’est important de les faire venir, qu’ils voient dans quel cadre on est, comment on travaille. Dans ce cas-là, mon tempérament de méridional aide ; effectivement, quand les gens nous rendent visite, je communique facilement avec eux, c’est moins anonyme que de s’installer derrière une table dans une exposition d’artisanat. On trouve que du point de vue de la qualité des échanges, de la manière dont on vit, on est privilégié. »
Pourquoi la céramique ?
« Ce qui m’a accroché, c’est qu’on travaille avec tous les éléments : la terre, le feu, l’air, l’eau. C’est un métier difficile ; on ne le maîtrise jamais vraiment, on se fait tout le temps surprendre, ça nous renvoie à nous-même.
Tout le monde fait l’association céramique et objets utilitaires. Mais des choses absolument extraordinaires existent, des sculptures, des installations, des œuvres en cours d’exécution, des œuvres avec d’autres matériaux, des murales…
À côté de mon tour, j’ai une photo de Picasso assis sur un tour à pied. Picasso n’a jamais su tourner ! Ça ne l’intéressait pas ! Il a passé dix ans à l’atelier Madoura dans le village de Vallauris en Provence, dans le sud de la France ; il avait un tourneur qui tournait pour lui un objet traditionnel. Picasso s’asseyait ensuite sur le tour et s’appropriait l’objet en le déformant, en le découpant, en le sculptant. Il faisait ça dans les années cinquante ! Picasso déjà à cette époque poussait dans le sens de la céramique d’expression. »
Nous terminons cette belle rencontre sur une phrase pas finie, suivie d’un soupir éloquent qui contient toutes les aspirations de Michel Louis Viala, tout ce qui reste à faire, à bâtir, à inventer, et j’y entends encore ce besoin qu’il manifeste constamment de fédérer, de rassembler, de réunir, qui témoigne de son amour des gens et de la vie.