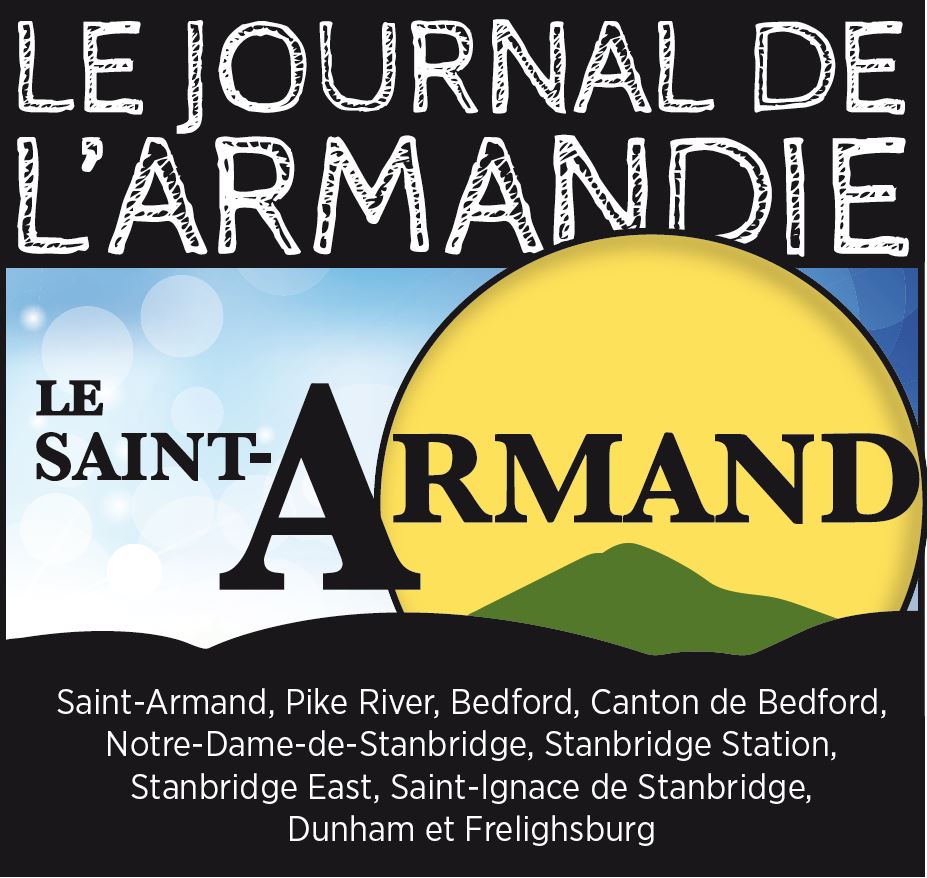Photo : Richard-Pierre Piffaretti
Il y aura bientôt cinq ans, nous avons publié un reportage, sonnant l’alarme au sujet de la crise qui guettait les médias d’information. Nous en arrivions à la conclusion que l’information est un bien public et non pas un produit de consommation et que, à ce titre, elle doit faire l’objet d’un solide soutien financier de la part de l’État. Nous republions ici ce reportage, au moment où nous avons dû renoncer à publier la version papier de notre journal et où nous peinons à trouver un moyen de poursuivre notre travail sous forme numérique.
Dès le début des travaux de la commission parlementaire sur l’avenir des médias, qui se tenait à Québec à la fin du mois d’août, Marie-Ève Martel, journaliste à La Voix de l’Est et auteure de l’essai Extinction de voix, plaidoyer pour la sauvegarde de l’information régionale, soutenait que « l’avènement des nouvelles technologies numériques et la captation des revenus publicitaires par des géants américains du Web mettent en péril de nombreux journaux ». La majorité des intervenants qui se sont succédé devant les commissaires ont dénoncé le fait que les agrégateurs de nouvelles, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), sont en grande partie responsables des difficultés que connaissent actuellement la plupart des médias d’information dans le monde.
« Pour protéger le droit du public à être correctement informé, ajoutait-elle, il apparaît désormais nécessaire que l’information […] soit admise formellement comme étant un bien public et que, en ce sens, elle soit soutenue de diverses manières par la société tout entière, y compris par des fonds publics. » Cette idée a également fait consensus lors des consultations de la commission, à l’exception notable du grand patron de presse Pierre Karl Péladeau, qui s’oppose à l’idée que l’État vienne en aide aux médias étant donné que selon lui, l’information est un produit marchand comme un autre. A-t-il oublié que Vidéotron, dont il est propriétaire, a largement bénéficié de fonds publics dans le passé ?
L’an dernier, le gouvernement du Québec a dépensé pas moins de 3,7 millions de dollars en publicité sur les plateformes des géants du Web, soit 12 % de son budget publicitaire, comparativement à 9 % l’année précédente. Quant aux sociétés d’État québécoises, soulignons qu’Hydro-Québec, Loto-Québec et la Société des alcools du Québec (SAQ) achètent à elles seules autant de messages publicitaires sur les GAFAM que l’ensemble des ministères.
 Selon des données obtenues par le journal Le Devoir en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics, en 2018, Hydro-Québec a dépensé 753 553 $ sur Facebook et Google, soit 14,5 % de son budget publicitaire tandis que, en 2018-2019, Loto-Québec versait à ces deux géants 1,4 million et la SAQ, 867 459 $, soit respectivement 8,2 % et 13,8 % de leur budget publicitaire. En conséquence, la SAQ a radicalement réduit ses dépenses publicitaires dans la presse imprimée. Citons, à titre d’exemple, Le Soleil, où la société d’État a amputé des trois-quarts ces dépenses.
Selon des données obtenues par le journal Le Devoir en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics, en 2018, Hydro-Québec a dépensé 753 553 $ sur Facebook et Google, soit 14,5 % de son budget publicitaire tandis que, en 2018-2019, Loto-Québec versait à ces deux géants 1,4 million et la SAQ, 867 459 $, soit respectivement 8,2 % et 13,8 % de leur budget publicitaire. En conséquence, la SAQ a radicalement réduit ses dépenses publicitaires dans la presse imprimée. Citons, à titre d’exemple, Le Soleil, où la société d’État a amputé des trois-quarts ces dépenses.
Selon le Canadian Media Concentration Research Project (http://www.cmcrp.org/), au Canada, en 2017, Google et Facebook se partageaient 74 % des 6,8 milliards de dollars de revenus publicitaires sur le Web. Et le phénomène est mondial. Tant et si bien que l’OCDE compte déposer un projet de taxation mondiale sur le numérique d’ici la fin de 2019 qui pourrait entrer en vigueur à la mi-2020. Au Canada, Justin Trudeau, qui s’y était fortement opposé jusqu’ici, a récemment laissé entendre qu’il envisagerait peut-être la chose s’il était réélu…
L’information marchandise
 Selon Raymond Corriveau, professeur associé au département de Lettres et communication sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières, ancien président du Conseil de presse du Québec et membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la communication, l’information et la société (CRICIS), on a fait l’erreur « de croire de manière naïve à la notion de marché pour une denrée qui n’est pas une marchandise » (l’information). Il remet en question le modèle d’affaires traditionnel qui fait reposer le financement des médias d’information sur la seule vente d’espaces publicitaires et il préconise une formule qui tablerait moins sur l’information marchandise et davantage sur le bien public.
Selon Raymond Corriveau, professeur associé au département de Lettres et communication sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières, ancien président du Conseil de presse du Québec et membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la communication, l’information et la société (CRICIS), on a fait l’erreur « de croire de manière naïve à la notion de marché pour une denrée qui n’est pas une marchandise » (l’information). Il remet en question le modèle d’affaires traditionnel qui fait reposer le financement des médias d’information sur la seule vente d’espaces publicitaires et il préconise une formule qui tablerait moins sur l’information marchandise et davantage sur le bien public.
« L’avenue la plus réaliste, écrit-t-il, aussi bien pour l’information que pour les médias, est celle de la formule coopérative proposée par la Fédération nationale des communications (FNC-CSN). Si, pour La Presse Plus, il n’y a plus assez d’argent de disponible pour satisfaire la production d’une information de qualité et l’appétit d’éventuels actionnaires, cela risque d’être vrai pour pas mal de monde. »
Raymond Corriveau reproche aux entreprises de presse d’avoir trop souvent, par le passé, fait la sourde oreille devant les revendications citoyennes en matière d’information. « Au fil des années, fait-il remarquer, des dizaines d’opérations de consultation de tout genre et des centaines de mémoires provenant de la société civile ont été néantisés par la pression du lobby des entreprises de presse. Si les propositions de la société civile avaient été écoutées, nous serions peut-être déjà à peaufiner des solutions bien en place. »
 Le professeur pense aussi que le Conseil de presse du Québec (CPQ), qu’il a autrefois présidé, n’est plus en mesure de répondre adéquatement aux exigences de son mandat du fait qu’il est entièrement asservi aux intérêts des grandes entreprises de presse. Selon lui, sa mission consiste à assurer la qualité de l’information et le respect de la déontologie journalistique et non pas la prospérité des propriétaires de presse. « La déontologie n’est pas une distraction, insiste-t-il, et le pouvoir réclamé par la presse pour cacher des informations aux autorités policières et judiciaires doit s’accompagner d’une contrepartie sociale qui ne peut être que déontologique. » Il déplore le fait qu’il n’existe présentement aucun organisme citoyen chargé de surveiller la qualité de l’information.
Le professeur pense aussi que le Conseil de presse du Québec (CPQ), qu’il a autrefois présidé, n’est plus en mesure de répondre adéquatement aux exigences de son mandat du fait qu’il est entièrement asservi aux intérêts des grandes entreprises de presse. Selon lui, sa mission consiste à assurer la qualité de l’information et le respect de la déontologie journalistique et non pas la prospérité des propriétaires de presse. « La déontologie n’est pas une distraction, insiste-t-il, et le pouvoir réclamé par la presse pour cacher des informations aux autorités policières et judiciaires doit s’accompagner d’une contrepartie sociale qui ne peut être que déontologique. » Il déplore le fait qu’il n’existe présentement aucun organisme citoyen chargé de surveiller la qualité de l’information.
Une aide de l’État ?
La plupart des patrons de presse se sont dit en faveur d’une aide financière de l’État, mais le mémoire présenté à la commission par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) a particulièrement retenu notre attention.
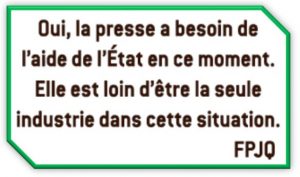 « Pourquoi les contribuables devraient payer pour soutenir une presse qui n’est plus financièrement viable ? La réponse est simple : parce que le prix à payer pour la société québécoise serait énorme. Le prix à payer, c’est la disparition des sources d’information, la fin dans certaines régions de l’essentielle pluralité des voix dans une démocratie en santé et le retour à l’obscurantisme », a soutenu Stéphane Giroux, président de la FPJQ.
« Pourquoi les contribuables devraient payer pour soutenir une presse qui n’est plus financièrement viable ? La réponse est simple : parce que le prix à payer pour la société québécoise serait énorme. Le prix à payer, c’est la disparition des sources d’information, la fin dans certaines régions de l’essentielle pluralité des voix dans une démocratie en santé et le retour à l’obscurantisme », a soutenu Stéphane Giroux, président de la FPJQ.
« En région, a-t-il poursuivi, ce sont souvent les journalistes de la presse écrite qui couvrent les assemblées des conseils municipaux, qui s’intéressent au travail des élus par exemple. Sans eux, les décisions seraient prises derrière des portes closes sans que les citoyens ne soient avisés. C’est la porte ouverte à des petites dictatures. On en a vu. »
La FPJQ estime que les entreprises de presse sont parfaitement justifiées de demander à l’État une aide financière. « Oui, la presse a besoin de l’aide de l’État en ce moment. Elle est loin d’être la seule industrie dans cette situation », a affirmé son président en rappelant celle accordée aux secteurs aéronautique et culturel. « L’indépendance des journalistes demeurerait intacte dans l’éventualité où le gouvernement accorderait une aide aux médias dans lequel ils travaillent », du fait que « les journalistes travaillent pour le public, seulement pour le public », a-t-il expliqué en rappelant aux élus que les quelque 1800 journalistes membres de la FPJQ s’engagent formellement à respecter le Guide de déontologie des journalistes du Québec.
Bernard Descôteaux et Colette Brin, tous deux professeurs au Centre de recherche sur les médias de l’Université Laval, ont également souligné que les médias sont « au bord du gouffre » et que la situation est suffisamment critique pour justifier une intervention de l’État « envisagée à long terme » afin d’assurer aux Québécois un accès à des sources d’information de qualité.
Information locale
L’Association Hebdos Québec (AHQ), un organisme à but non lucratif fondé en 1932 et qui regroupe des hebdomadaires locaux et régionaux indépendants, estime qu’il serait souhaitable « que le gouvernement du Québec et ses sociétés d’État reprennent le contrôle de leurs placements publicitaires et s’engagent à faire l’achat de publicités auprès des hebdos, peu importe le support utilisé, imprimé ou numérique. Cela serait une façon simple et efficace d’appuyer des entreprises québécoises qui s’échinent, parce qu’elles y croient, à maintenir en vie des médias d’information. » Les auteurs du mémoire de l’AHQ dénoncent « le rôle malsain joué par les grandes agences de publicité, qui détournent les annonceurs et leurs budgets des médias traditionnels et qui en tirent profit au passage. Ces agences ont contribué fortement à la crise actuelle et elles continuent de le faire sans que ce soit dit sur la place publique. »
 Le mémoire de l’AHQ propose au gouvernement de « créer un incitatif pour les commerçants, professionnels et franchisés locaux sous forme de crédit d’impôt pour les placements publicitaires dans les hebdos. Nous suggérons la mise en place d’un crédit d’impôt de 50 % des dépenses applicables à l’achat de publicités locales : imprimées et numériques. » On y appuie également les revendications de RecycleMédias pour que les journaux soient considérés de la même façon que les livres et soient exemptés de la taxe sur le recyclage. « Comme les autres écrits, les hebdos demeurent du domaine de la culture et ils méritent pareil statut. Une révision de cette pratique serait une manière relativement simple de donner un peu d’oxygène à nos membres. »
Le mémoire de l’AHQ propose au gouvernement de « créer un incitatif pour les commerçants, professionnels et franchisés locaux sous forme de crédit d’impôt pour les placements publicitaires dans les hebdos. Nous suggérons la mise en place d’un crédit d’impôt de 50 % des dépenses applicables à l’achat de publicités locales : imprimées et numériques. » On y appuie également les revendications de RecycleMédias pour que les journaux soient considérés de la même façon que les livres et soient exemptés de la taxe sur le recyclage. « Comme les autres écrits, les hebdos demeurent du domaine de la culture et ils méritent pareil statut. Une révision de cette pratique serait une manière relativement simple de donner un peu d’oxygène à nos membres. »
Quant aux journaux communautaires comme Le Saint-Armand, l’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) a rappelé que, en 1995, le gouvernement du Québec s’engageait à leur consacrer 4 % des dépenses publicitaires de ses ministères et sociétés d’État, mais que l’objectif n’a jamais été atteint. Le Saint-Armand a obtenu des données qui montrent que les dépenses publicitaires de l’État et des sociétés qui en dépendent ont radicalement diminué au cours des 15 dernières années. Présentement, ces instances dépensent dans ces médias moins de 15 % du montant qu’elles leur consacraient au début des années 2000. Au cours des quatre dernières années, ce montant n’a pas dépassé les 2 % de leurs frais publicitaires. Selon l’AMECQ, il est « impératif que le gouvernement respecte son engagement d’un placement publicitaire de 4 % pour les médias communautaires, engagement qui contribuait par le passé à aider à offrir aux citoyens des nouvelles de leur quartier, grâce au concours de bénévoles qui donnent une crédibilité supplémentaire à notre système démocratique. Ce sont, après tout, les citoyens qui paient pour ces services ou ces publicités dans les médias. Toutefois, l’application de l’énoncé des 4 % ne doit pas être laissée seulement entre les mains des fonctionnaires des ministères ou des employés des agences de publicité, elle se doit d’être politique et la directive doit provenir des élus. »
En guise de conclusion
Qu’elle passe par l’écrit, l’audio ou la vidéo, qu’elle soit diffusée par les voix analogiques ou numériques, l’information demeure essentielle à la vie démocratique. Par conséquent, elle doit être reconnue comme un bien public, nécessaire et indispensable. L’acte de produire et de diffuser de l’information doit donc être justement rémunéré et soumis à des règles qui en garantissent la qualité et l’indépendance vis-à-vis des lobbys, quels qu’ils soient.