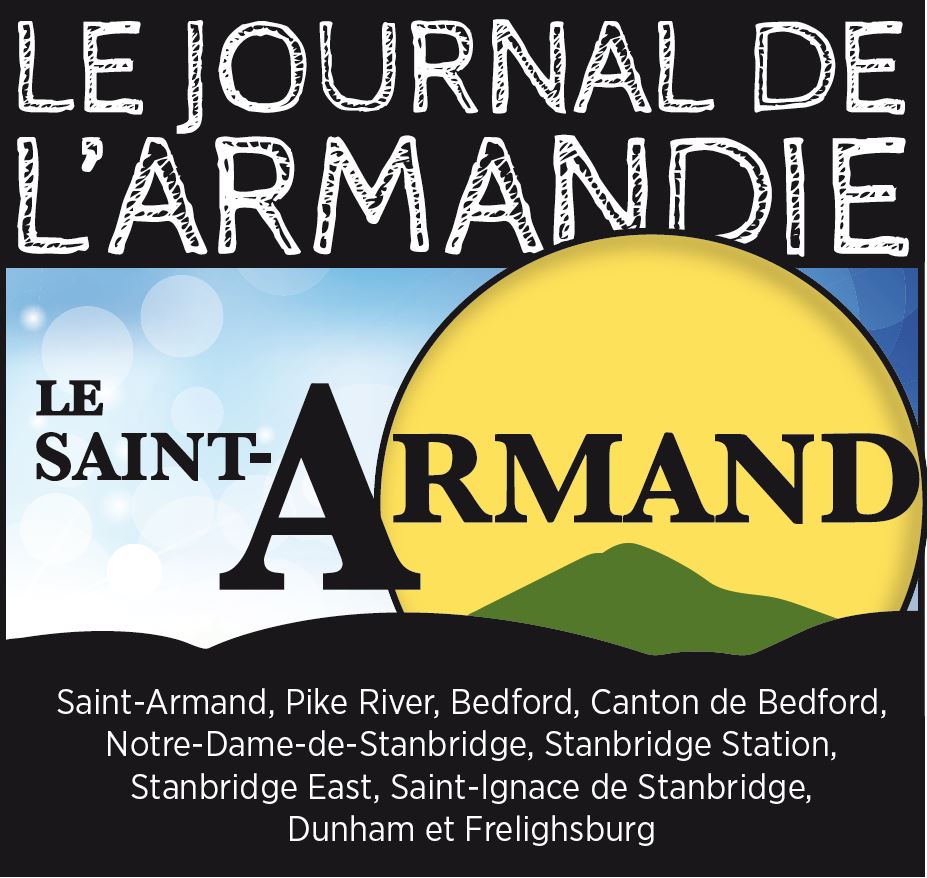Le ministre Lamontagne accouche d’une souris verte
 Le 22 octobre dernier, André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dévoilait son plan vert agricole pour les dix prochaines années. Intitulé Agir pour une agriculture durable, ce plan prévoit des investissements de 12 millions par année dans le but de réduire de 15 % les épandages de pesticides et d’engrais chimiques sur les terres, les apports en phosphore dans les cours d’eau et à diminuer d’autant la détérioration des sols agricoles. Cela signifie que, si ces objectifs sont atteints, ce qui est loin d’être acquis, 85 % des polluants agricoles continueront de compromettre l’environnement au terme des dix prochaines années.
Le 22 octobre dernier, André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dévoilait son plan vert agricole pour les dix prochaines années. Intitulé Agir pour une agriculture durable, ce plan prévoit des investissements de 12 millions par année dans le but de réduire de 15 % les épandages de pesticides et d’engrais chimiques sur les terres, les apports en phosphore dans les cours d’eau et à diminuer d’autant la détérioration des sols agricoles. Cela signifie que, si ces objectifs sont atteints, ce qui est loin d’être acquis, 85 % des polluants agricoles continueront de compromettre l’environnement au terme des dix prochaines années.
On pourrait se demander pourquoi les objectifs visés par le plan québécois sont si modestes. Selon Roméo Bouchard, fondateur de l’Union paysanne et de la coalition Sauver les campagnes, c’est parce que « monocultures intensives, élevages intensifs hors sol, hyperspécialisation, concentration et intégration des productions, production d’exportation sont impensables sans pesticides et engrais chimiques. On a donc raison de dire que les interdire purement et simplement équivaudrait à détruire la quasi-totalité de l’agriculture des pays industrialisés. Il ne faut donc pas s’étonner que ce plan vert ne nous propose, sur 10 ans, que de diminuer ces intrants toxiques de 15 % plutôt que de nous proposer un plan de sortie de l’agriculture chimique intensive. Car pour en sortir, il faudrait planifier une métamorphose complète de ce modèle agricole dominant choisi par l’UPA et les gouvernements durant les années 1990, lequel consiste à jouer le jeu du libre-échange à fond et à marginaliser l’agriculture familiale de subsistance. »
 Roméo Bouchard pense au contraire que « c’est toute l’agriculture actuelle qu’il faudrait recycler prioritairement en agriculture de proximité, d’autonomie alimentaire et d’occupation du territoire. » Pour lui, il est clair que le plan du ministre Lamontagne ne pourra d’aucune façon transformer l’agriculture québécoise en une activité durable.
Roméo Bouchard pense au contraire que « c’est toute l’agriculture actuelle qu’il faudrait recycler prioritairement en agriculture de proximité, d’autonomie alimentaire et d’occupation du territoire. » Pour lui, il est clair que le plan du ministre Lamontagne ne pourra d’aucune façon transformer l’agriculture québécoise en une activité durable.
À la lumière de ce que la pandémie actuelle nous a enseigné, ne serait-il pas sage de miser sur l’agriculture de proximité et une plus grande autonomie alimentaire, plutôt que sur une agriculture fondée sur l’exportation et qui nécessite l’inéluctable détérioration de l’environnement ?
Le ministre Charrette donne aussi dans le vert pâle
Le 16 novembre, Benoit Charrette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, accompagné du premier ministre François Legault, dévoilait le Plan pour une économie verte du gouvernement québécois.
 « L’agriculture biologique n’est pas reconnue à sa juste valeur pour ses apports à la durabilité de l’agriculture au Québec », estime Caroline Poirier, présidente de la Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique. Déjà déçue par le Plan pour une agriculture durable, rendu public le 22 octobre, cette maraîchère estime que le Plan pour une économie verte passe lui aussi à côté de la cible en restant silencieux sur la nécessité de développer une agriculture véritablement durable.
« L’agriculture biologique n’est pas reconnue à sa juste valeur pour ses apports à la durabilité de l’agriculture au Québec », estime Caroline Poirier, présidente de la Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique. Déjà déçue par le Plan pour une agriculture durable, rendu public le 22 octobre, cette maraîchère estime que le Plan pour une économie verte passe lui aussi à côté de la cible en restant silencieux sur la nécessité de développer une agriculture véritablement durable.
« L’agriculture biologique, fait-elle remarquer, vise la santé des sols, la diversification des cultures, la résilience des systèmes agricoles, de façon normée avec des pratiques très précises. C’est une vision élaborée depuis longtemps, qui contribue à l’augmentation de la matière organique dans le sol ». Selon le gouvernement du Québec, les activités agricoles comptent pour près de 10 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES). Madame Poirier aurait souhaité que le Plan pour une économie verte envisage un soutien direct au mode de production biologique et la commercialisation en circuit court. « Ça permet de réduire le gaspillage alimentaire, et donc de diminuer l’empreinte écologique en produisant moins de GES », juge-t-elle.
Selon Patrick Mundler, professeur en économie agroalimentaire à l’Université Laval, l’agriculture biologique présente des avantages sur le plan écologique, notamment parce qu’elle interdit l’emploi des engrais de synthèse azotés générateurs de GES et qu’elle favorise la rétention, ou séquestration, de CO2 dans le sol.
À l’Union des producteurs agricoles (UPA), on émet des doutes au sujet des bienfaits de l’agriculture biologique. « Si je produis bio, mais que je suis obligé de cultiver deux fois plus grand (en raison d’une productivité amoindrie), est-ce que, à terme, le résultat est meilleur ? demande Marcel Groleau, président de l’UPA. On n’a pas fait une démonstration très claire que, en ce qui a trait aux GES, l’un est préférable à l’autre à grande échelle. »
 Maxime Laplante, producteur de céréales biologiques, pense au contraire qu’il faut cesser de favoriser les grandes monocultures au détriment des petits agriculteurs. « Ça oblige l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques. Si j’avais 1000 hectares de maïs, sincèrement, j’ai beau être agronome, je n’ai aucune idée de comment je pourrais gérer ça sans recourir à des pesticides », affirme-t-il. Il déplore, par ailleurs, le fait qu’on doive être propriétaire d’un grand troupeau de bétail pour être admissible à certains programmes d’aide de la Financière agricole, comme le Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles.
Maxime Laplante, producteur de céréales biologiques, pense au contraire qu’il faut cesser de favoriser les grandes monocultures au détriment des petits agriculteurs. « Ça oblige l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques. Si j’avais 1000 hectares de maïs, sincèrement, j’ai beau être agronome, je n’ai aucune idée de comment je pourrais gérer ça sans recourir à des pesticides », affirme-t-il. Il déplore, par ailleurs, le fait qu’on doive être propriétaire d’un grand troupeau de bétail pour être admissible à certains programmes d’aide de la Financière agricole, comme le Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles.