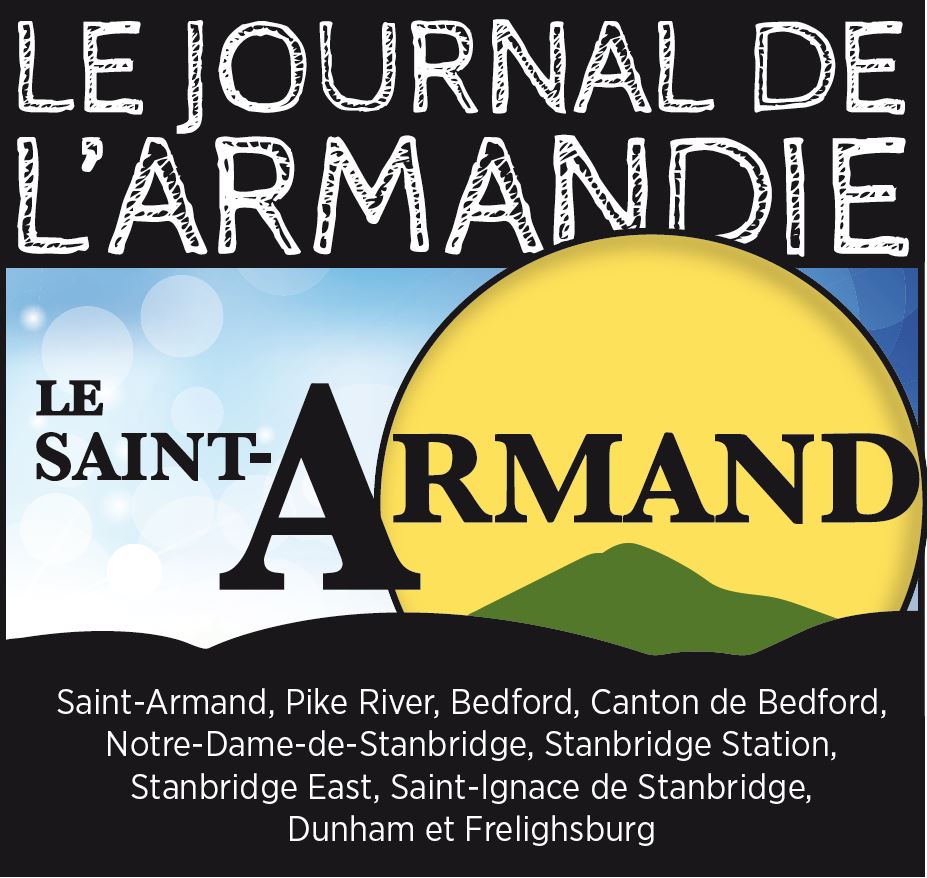Du 22 juin au 14 octobre, le Musée des communications et d’histoire de Sutton* propose une exposition consacrée au réalisateur Pierre Falardeau qui, de 1976 jusqu’à son décès en 2009, a eu une résidence secondaire dans la région. L’exposition a été préparée en collaboration avec Manon Leriche, documentariste et conjointe de Pierre. Le texte qui suit est de leur fils Jules, également cinéaste.
C’est drôle parce que, quand on vient m’en parler, c’est souvent pour me raconter une anecdote. La fois où telle ou telle personne l’a croisé. À quel point il l’a marquée, par sa gentillesse ou par un conseil un peu brutal, peu importe, ça reste en mémoire. Il y a 2 ou 3 ans, un jeune cinéaste m’a raconté l’avoir approché à un moment donné : « J’aimerais ça faire du cinéma politique. Auriez-vous un conseil ? ». Mon père a réfléchi brièvement avant de répondre : « Ouais… Habitue-toi au goût du beurre de peanut ». Ça m’a jeté par terre. Tant de poésie et d’intelligence dans cette phrase qui laisse transparaître aussi son sens de l’humour redoutable. En plus, quand on connaît la manière dont fonctionne le cinéma québécois, cette phrase nous frappe. « On ne fait pas les films qu’on devrait faire » disait-il aussi au grand critique Georges Privet.
Pourquoi tout le monde a une anecdote d’une rencontre avec mon père ? Il jasait avec tout le monde. Il aimait discuter avec le monde, avec son peuple. Il était sincère et les gens le sentaient. Ça aura marqué chacun à sa manière ; du chauffeur de taxi marocain au jeune cinéaste de la Côte-Nord, du gars de shop qui lui faisait signer une vieille napkin à la taverne du coin, à la vieille dame anglaise pour qui il avait porté ses sacs d’épicerie. Un humaniste doublé d’un vieux fond scout.
Et pour le beurre de peanut, il parlait en connaissance de cause. Faire du cinéma politique au Québec, il l’aura vécu à la dure dans un système de financement de type soviétique à la sauce canadian : les « commissaires du peuple » qui décident de ce qui va exister comme cinéma, avec une petite touche d’économie de marché. Le meilleur des deux mondes au pays du castor gras. Ses films ont tout de même réussi à exister après d’interminables luttes. Quinze ans pour Octobre, dix pour 15 février 1839. Le temps des bouffons, lui, aura été réalisé en toute liberté, en marge de ce système, sorti dix ans après le tournage, « fait avec pas une cenne ». Voilà le principe de ce système. Tu peux le faire ton film subversif, mais à la sueur de ton front, avec ton argent de poche, avec l’huile de bras de collaborateurs qui y croient comme toi. Pendant ce temps, on envoie les moins menaçants se pavaner à Cannes ou à Berlin, « téter des crevettes congelées sur le tapis rouge » comme il aurait dit.

Une autre anecdote me vient en tête, cette fois-ci sur le tournage du film Le Steak. L’équipe devait tourner une scène à l’accueil Bonneau. Le préposé à l’entrée a vu entrer mon père et lui a indiqué qu’il restait de la place dans le fond, le prenant pour un « robineux » affamé. Et je ne crois pas que ça le dérangeait. Il assumait ses vêtements usés à la corde. Ce n’est même pas qu’il les assumait, il n’en avait rien à cirer. Il détestait consommer. Ça a toujours été comme ça. Alors être pauvre dans ce contexte…
La dignité avait une plus grande valeur à ses yeux que la réussite matérielle. C’est peut-être pour cela qu’il aimait tellement l’analyse de Pier Paolo Pasolini sur la société de consommation qui était pour lui le vrai fascisme par le totalitarisme de la consommation. Un vieux char, une vieille chemise à carreaux, ses vieux running shoes qui dataient de vingt ans (dans le temps que la destruction programmée des biens était moins agressive et que les trucs étaient encore fabriqués pour durer), des vieux bas tellement usés, l’élastique qui ne tenait plus rien.
À la blague on lui disait qu’on finirait par exposer ses bas dans un musée.
À l’exposition « Falardeau, l’homme révolté » du Musée de Sutton, vous ne verrez sans doute pas ses vieux bas, quoique ça aurait été une bonne blague dont il aurait lui-même ri, mais vous verrez pas mal d’affaires intéressantes. Je ne vendrai pas le punch mais je pense que ça en vaudra la peine.
Pourquoi l’Estrie, ancienne terre de loyalistes, le célèbre-t-elle comme ça ? À sa mort, les gens de Mansonville lui avaient rendu hommage. Je n’avais pu m’y rendre, mais j’ai visionné la vidéo. C’était un hommage simple et touchant. De l’écrivain Serge Beauchemin en passant par M. Giroux, le quincailler, et M. Ducharme, l’épicier, et cette dame si contente de partager la dernière photo qu’elle avait prise de lui, chacun se remémorait des anecdotes de cet homme qu’ils avaient connu : coups de gueules, ou des histoires toutes simples.
Les Cantons-de-l’Est ont été un endroit bien spécial pour lui. Un endroit qu’il avait adopté à la fin des années 1970, s’achetant une maison en ruine, qu’il a retapée lui-même avec des matériaux qu’il ramassait un peu partout. Des planches venant d’une maison en démolition, une table venant d’une maison abandonnée, une chaise ramassée dans les poubelles, des fenêtres données par je ne sais qui, etc. Un endroit où il pouvait contempler la nature de son pays, se ressourcer avant de retourner « au batte », seul contre tous, pour défendre un film ou un article. Un endroit où il avait la « criss » de paix, loin de toute l’agitation du débat public. À son arrivée ici, il avait même scié le poteau de téléphone… juste pour être sûr.

Cette force qui le caractérisait, il la trouvait dans ces moments simples de la vie, au sommet d’une montagne enneigée qu’il avait gravie en ski de fond ou à couper son bois à la sciotte, trop pauvre pour s’acheter une chainsaw. Il trouvait cette force dans les encouragements du monde, un camionneur qui avait vu Le temps des bouffons, une infirmière qui a pleuré en regardant 15 février, le quincailler du village qui trouvait ça tordant de savoir qu’il avait croisé tel journaliste connu sur la rue et qu’il l’avait envoyé chier.
C’est un peu tout ça qu’on se remémore à la veille du 10e anniversaire de sa mort. Ses cris, ses sacres, ses rires, ses films, ses livres, ses articles, ses exploits. Ces moments simples qui appartiennent à chaque personne qui l’a connu ou qui l’a croisé rien qu’une fois. Et ses vieux bas usés à la corde.
* Le musée est situé au 32, Principale Sud (514 891-9560).