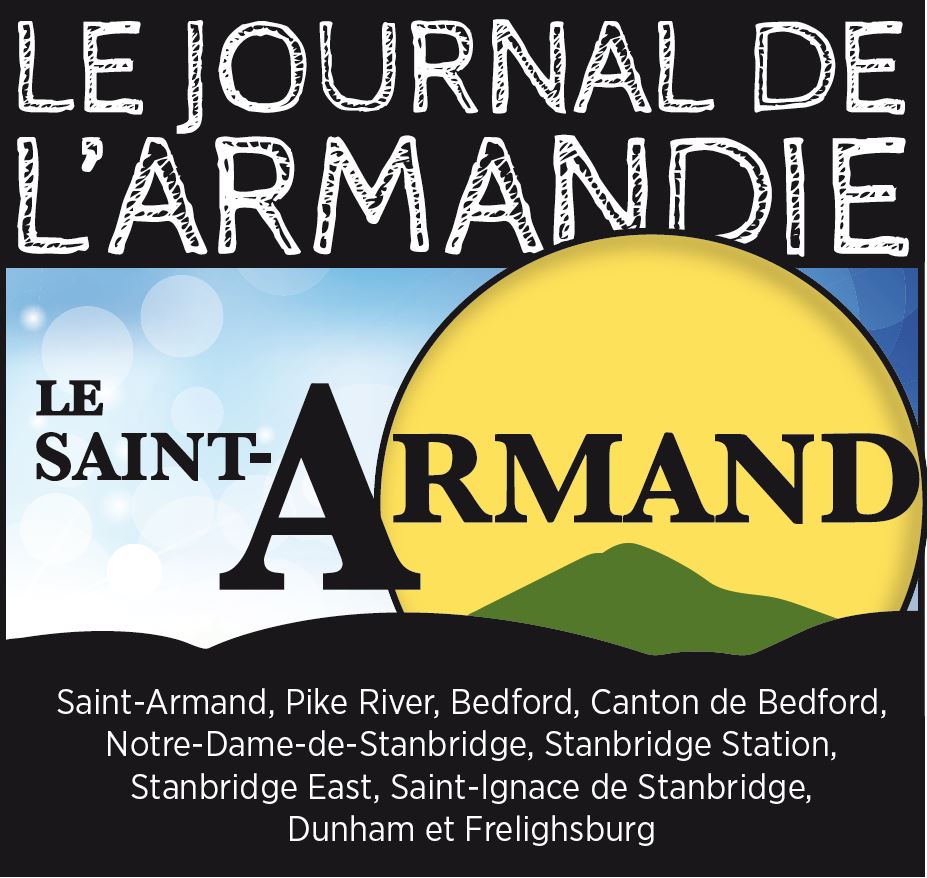Estelle Bernard. Photo : François Charbonneau
Qui suis-je ? Où vais-je ? Quel chemin emprunter pour calmer cette quête existentielle, pour donner du sens à ce passage sur Terre ? Pour neutraliser cette angoisse profonde de vivre. À travers ma démarche artistique, je trouve mon chemin. Je connecte avec mon « essence-ciel ». Je deviens le Chemin qui dort en dedans de moi et je le suis et je le Suis.
Voilà qui condense, en quelques mots, la démarche artistique d’Estelle Bernard, laquelle démarche s’appuie sur une existence entière à vouloir comprendre ce qui se cache au plus profond de l’âme humaine.
Cette artiste multidisciplinaire qui a pris le pinceau sur le tard, à l’issue d’une longue carrière comme travailleuse sociale, n’a de cesse, depuis, d’exprimer à travers la peinture, l’estampe, la céramique, la fabrication du papier son questionnement, certes, mais aussi sa fascination pour les matières et les végétaux, et son amour de la Nature, qu’on se doit ici d’écrire avec un grand N tellement cela ressemble dans ses propos à une divinité oubliée, puis retrouvée.
Le parcours de l’artiste est sinueux, rempli d’obstacles et d’interruptions, la vie et ses imprévus ayant leurs exigences propres. Elle sait depuis toujours que réside en elle ce besoin impérieux d’exprimer longuement l’indicible, mais il faudra attendre que les bons ingrédients soient réunis pour le faire. Entre-temps, elle s’instruit. Auprès de Maya Lightbody, née Maria Smodlibowska, une Polonaise arrivée au Québec en 1951 et formée à la peinture, au graphisme et à la sculpture, qui avait ouvert son atelier aux néophytes souhaitant explorer diverses techniques artistiques. Ce sera l’étincelle de départ. Aussi auprès de Seymour Segal, artiste-peintre qui se décrit également comme un « provocateur de créativité » et qui lui enseignera le pouvoir qu’a la peinture de nous révéler à nous-mêmes. C’est une immense fenêtre qui vient de s’ouvrir et qui ne se refermera plus. Auprès d’autres également, desquels elle recevra le savoir nécessaire à sa reconstruction artistique. Car nous sommes tous des artistes déconstruits, n’est-ce pas ?
Elle glane, la glaneuse, chez Bénédicte Deschamps, chez Bernice Sorge, chez Micheline Durocher, chez Hélène Duperon, chez Hélène Lessard, chez Sara Mills et Michel-Louis Viala, des morceaux de connaissance, des bouts d’inspiration qu’elle stocke dans sa mémoire, mais aussi dans ses mains et ses bras, lieux corporels où l’art va s’exprimer sans impératif ni dessein. Seymour Segal ne lui a-t-il pas appris que c’est le processus qui compte, celui qui consiste à rester centré sur ce vers quoi le mouvement du bras, le mouvement du pinceau, le mouvement de la spatule cherchent à amener l’artiste ?
Prudente, elle suit son petit bonhomme de chemin, participant à de nombreuses expositions collectives entre 2002 et 2020, sans oser se lancer seule dans l’aventure. Puis, en 2021, c’est le grand déblocage. Comme si toutes les chaînes intérieures et extérieures venaient soudainement de se briser. On lui propose une exposition solo à la bibliothèque de Cowansville, ce lieu de savoir où les mots prennent toute leur importance. Le thème s’impose de lui-même : Je Suis le Chemin. Belle ambiguïté entre ce que l’on est et ce que l’on suit qui réside dans la structure même de notre langue.

Il m’a semblé, en écoutant Estelle Bernard, qu’une partie de son œuvre émergeait de cette interface entre l’enfant égratignée par les contrecoups de la guerre qu’elle a été et la multitude de petits êtres meurtris pour qui, durant vingt-cinq ans, elle a cherché des foyers capables de les aimer envers et contre tous, et parfois contre eux-mêmes. Il en ressort une lumière tantôt diffuse, tantôt éclatante, mais qui émane toujours de la quête d’un soi désireux de se dépouiller de ses atours, de mettre à nu le contenu de l’inconscient afin de se retrouver soi-même, savoir qui on est – je suis le chemin.
À cette exploration d’un intérieur jamais entièrement compris et qui oblige à poursuivre inlassablement la quête de soi, s’ajoutent des créations plus ludiques, souvent expérimentales, qui s’expriment beaucoup sur le papier, le fait main, le japonais, le népalais, le Somerset et le « de guêpe », ce dernier étant récupéré sur les nids abandonnés de guêpes sociales, qui les fabriquent en mastiquant du bois mélangé à leur salive. Incrustations de prêle, d’algues, de fleurs de tilleul ou de panais sauvage, broderies en fil de lin ou fibres de vieux jean contribuent à créer des paysages qu’on dirait faits de bribes d’enfance préservées de l’implacabilité d’un monde adulte replié sur sa souffrance. On aurait envie de les décortiquer tous pour retrouver les différents moments qui ont présidé à leur naissance.
À savoir :
- Il va de soi qu’un article comme celui-ci ne peut rendre compte que d’une infime partie de l’exposition qui a été présentée cet automne par Estelle Bernard à la bibliothèque de Cowansville. Ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de la voir peuvent toujours se consoler en se procurant le magnifique catalogue conçu et réalisé par le graphiste Daniel Lefèbvre, de Dunham, et vendu par l’artiste au coût de 25 $. Voir également le site web du journal (https://journalstarmand.com/) où sont publiés des éléments complémentaires.
- Pour discuter avec l’artiste de son œuvre ou pour tout autre renseignement, composez le 514 922-8539 ou écrivez-lui à estellebernard7@gmail.com
Cliquer ici pour voir les compléments à cet article : Estelle Bernard va son chemin (compléments numériques)