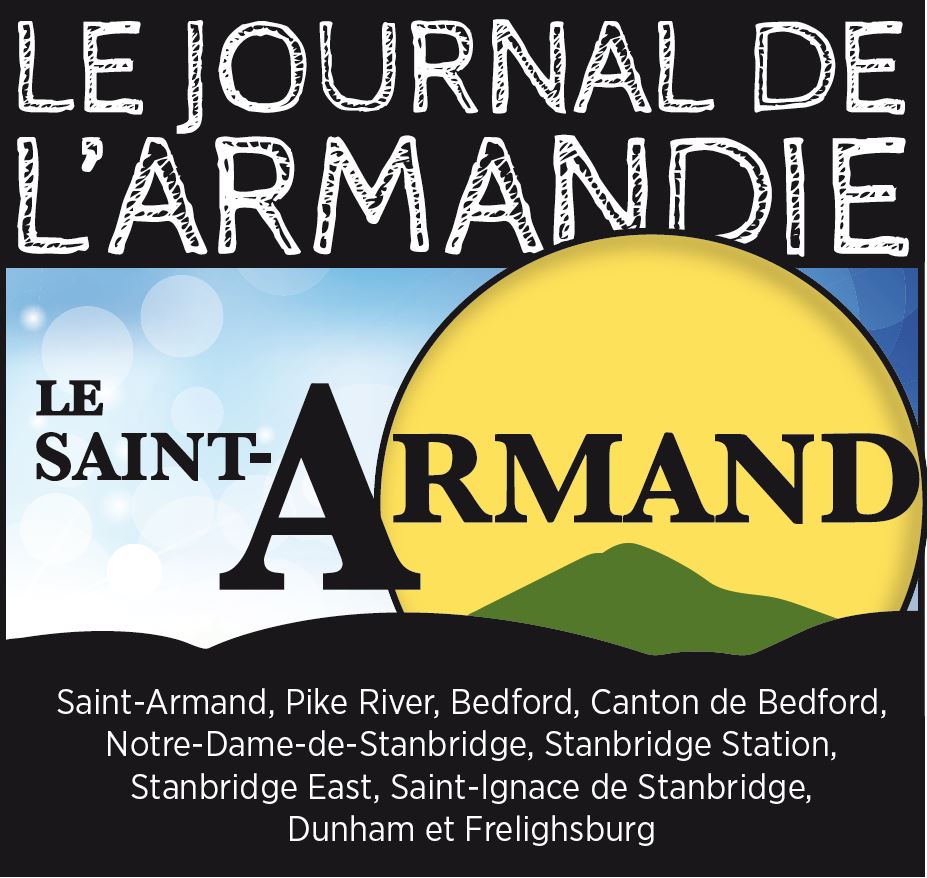Photo : http://leica-geosystemes.com
En 2008, le gouvernement libéral de Jean Charest affirme son désir de réformer le modèle agricole québécois. Cinquante-cinq ans après la dernière réforme, le fleuron de l’identité québécoise craque de partout. La Financière agricole accumule des pertes de plus d’un milliard. L’assurance-stabilisation encourage la surproduction pour des cultures et des élevages non rentables. Le monopole syndical de l’Union des producteurs du Québec (UPA) est contesté et, malgré les efforts accomplis dernièrement, les environnementalistes accusent toujours ces derniers d’être au cœur des problèmes de fertilité des sols et de pollution de l’eau.
Après la remise du rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (CAAAQ -Rapport Pronovost) en 2008 et des rapports St-Pierre et Ouimet en 2009, le gouvernement libéral s’était fixé jusqu’en 2010 pour accoucher d’une nouvelle politique. Depuis ce temps, les artisans de l’agroalimentaire et de l’agriculture nagent dans le néant. Quelles directions emprunteront les nouvelles mesures de Québec ? Chose certaine, d’après ce qu’a laissé entendre le ministre de l’agriculture, Claude Béchard, les changements s’annoncent importants. Premier tressaillement en 2009 : le budget de la Financière agricole sera limité à 630 millions annuellement et le cheptel de porcs assurables à 7 millions.
Malgré des dissensions, tous les acteurs du milieu s’entendent sur plusieurs points. Le gouvernement doit continuer de subventionner l’agriculture. Ils attendent de savoir quelles seront les priorités de la politique : la relève agricole, l’environnement, la productivité, les exportations, le terroir ? Une chose est sûre, les fermiers ont besoin de redorer leur blason auprès du grand public après plusieurs années tumultueuses : listériose, grippe aviaire, grippe porcine, algues bleues vert, fièvre aphteuse, vache folle, organisme génétiquement modifié (OGM) et le scandale de l’eau contaminée à Walkerton en Ontario ont plongé l’agriculture dans une crise de légitimité.
C’est la réforme du voisin
La perte de légitimité de l’agriculture n’est pas propre au Québec, ni la volonté de réformer les structures de soutien. Depuis quelques années, l’ensemble des pays occidentaux se penchent sur la question. C’est surtout la crise alimentaire en 2008 qui a accéléré la réflexion sur l’avenir des campagnes. Le gouvernement peut s’inspirer de plusieurs pays, mais doit prendre en considération la position nordique du Québec. Les terres cultivables ne représentent que deux pour cent du territoire. Le constat de la Commission Pronovost est alarmant : « Le secteur agricole et agroalimentaire est en train de se refermer sur lui-même. Les systèmes qu’il a mis en place créent des obstacles à l’émergence de nouveaux types d’agriculture, au développement de produits originaux et à l’exploration de nouvelles possibilités commerciales ». C’est toute la notion du terroir si populaire dans les discours politiques.
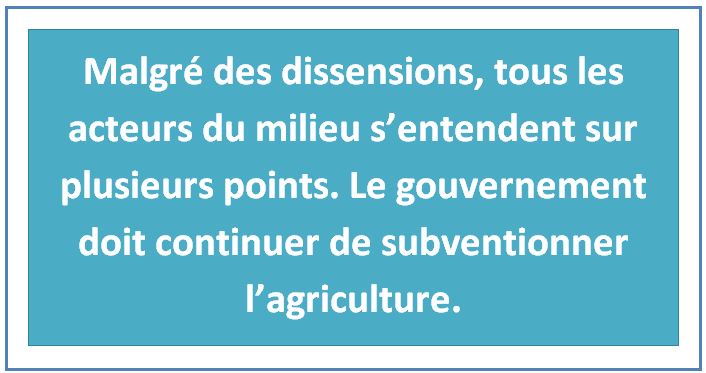 La Suisse est un cas intéressant et abondamment cité par l’Union Paysanne (UP) dans ses écrits. Depuis 2008, la nouvelle politique agricole est inscrite dans la Constitution. La loi prévoit que l’agriculture réponde à une logique de développement durable et contribue à la sécurité alimentaire, à la conservation des ressources naturelles et à l’occupation du territoire. Concrètement, l’agriculteur signe un contrat qui n’est pas axé sur sa productivité, mais sur l’atteinte de ces engagements. « On veut qu’un cultivateur qui décide de protéger sept pour cent de ses terres – un boisé, un marécage, les bordures d’une rivière – soit rémunéré », affirme le président de l’Union paysanne, Benoît Girouard. De son côté, l’Union Européenne (UE) est en pleine négociation pour réformer la politique agricole commune (PAC). Les difficultés des pourparlers soulèvent l’importance des caractéristiques sociales et territoriales de l’agriculture. Les vignerons roumains ne pouvaient pas concurrencer leurs collègues français fortement subventionnés. Avec l’entrée de la Roumanie dans l’UE, ses vignerons ont eu accès à des subventions. Le coût de production du vin roumain étant dérisoire par rapport à celui de l’Hexagone, c’est maintenant les vignerons français qui crient à la concurrence déloyale.
La Suisse est un cas intéressant et abondamment cité par l’Union Paysanne (UP) dans ses écrits. Depuis 2008, la nouvelle politique agricole est inscrite dans la Constitution. La loi prévoit que l’agriculture réponde à une logique de développement durable et contribue à la sécurité alimentaire, à la conservation des ressources naturelles et à l’occupation du territoire. Concrètement, l’agriculteur signe un contrat qui n’est pas axé sur sa productivité, mais sur l’atteinte de ces engagements. « On veut qu’un cultivateur qui décide de protéger sept pour cent de ses terres – un boisé, un marécage, les bordures d’une rivière – soit rémunéré », affirme le président de l’Union paysanne, Benoît Girouard. De son côté, l’Union Européenne (UE) est en pleine négociation pour réformer la politique agricole commune (PAC). Les difficultés des pourparlers soulèvent l’importance des caractéristiques sociales et territoriales de l’agriculture. Les vignerons roumains ne pouvaient pas concurrencer leurs collègues français fortement subventionnés. Avec l’entrée de la Roumanie dans l’UE, ses vignerons ont eu accès à des subventions. Le coût de production du vin roumain étant dérisoire par rapport à celui de l’Hexagone, c’est maintenant les vignerons français qui crient à la concurrence déloyale.
L’Ontario est aussi souvent citée en exemple. Surtout pour le dynamisme et l’efficacité de sa campagne Ontario, terre nourricière. Lancée en 1977, elle favorise l’identification, la publicité et la mise en tablette des produits frais de l’Ontario. Les résultats sont au rendez-vous. Le logo de l’organisme est identifiable, connu et répandu. Ce n’est pas la même situation pour Aliment du Québec qui peine à offrir un peu de visibilité aux produits d’ici. Il faut dire que le budget de son jumeau ontarien est 10 fois supérieur. Le reportage de L’Actualité du 1er avril 2010 « Manger Québécois, la grande illusion » rapporte bien la grande difficulté des cultivateurs à placer leurs produits sur les tablettes des supermarchés. Christian Lacasse, président de l’UPA, voudrait bien fixer un seuil à 50 % pour obliger les épiceries à s’approvisionner au Québec, mais il faudrait encore que les produits identifiés soient québécois. Ce qui n’est pas toujours le cas, selon le reportage. L’achat local, tous sont d’accords, mais le climat québécois rend l’objectif d’indépendance alimentaire irréaliste.
D’autres pays, comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, ont pris, en apparence, le virage d’une certaine libéralisation des marchés. Mais le Farm Bill américain, adopté en 2002 et reconduit en 2008, prévoit de généreuses aides. En tout, ce sont 95 milliards qui sont destinés à favoriser les fermiers, surtout pour les produits d’exportation. Encore une fois, le Québec ne peut prétendre concurrencer les agriculteurs de ces pays. La taille des fermes, beaucoup plus modeste ici, rendrait le modèle québécois désuet. L’UPA et l’UP sont contre une libéralisation. Selon eux, seules les multinationales bénéficieraient d’une telle orientation. Aux États-Unis, 72 % des subventions sont accordées à 10 % des plus gros producteurs. C’est encore la différence entre le paradigme industriel et agricole. « Il n’en est pas question », tranche Benoît Girouard.
Quand l’économie va, tout va
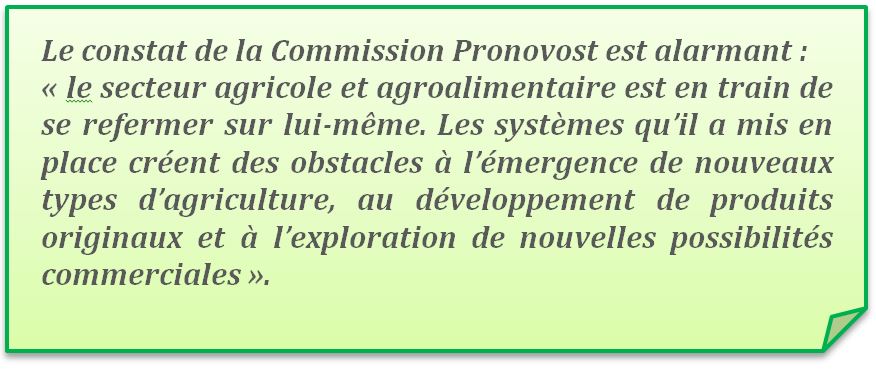 Ce n’est pas qu’une question de politique interne. Les pays émergents comme le Brésil, l’Inde et la Chine mettent de plus en plus de pression sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour éliminer les mesures protectionnistes de l’agriculture des pays riches. La crise alimentaire en 2008 a servi d’électrochoc. Plusieurs pays ont été secoués par de graves problèmes humanitaires et sociaux suite à l’explosion du coût des céréales, conjuguée à une hausse record de celui du pétrole. Jean Ziegler, ancien rapporteur de l’ONU pour le droit à l’alimentation, avait qualifié de « crime contre l’humanité » la folie de la course vers les bio-carburants, en partie responsable de cette inflation. Les États-Unis avaient opté pour cette solution afin de régler leurs problèmes d’indépendance énergétique envers le Moyen-Orient. C’était aux heures les plus sombres de la guerre en Irak.
Ce n’est pas qu’une question de politique interne. Les pays émergents comme le Brésil, l’Inde et la Chine mettent de plus en plus de pression sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour éliminer les mesures protectionnistes de l’agriculture des pays riches. La crise alimentaire en 2008 a servi d’électrochoc. Plusieurs pays ont été secoués par de graves problèmes humanitaires et sociaux suite à l’explosion du coût des céréales, conjuguée à une hausse record de celui du pétrole. Jean Ziegler, ancien rapporteur de l’ONU pour le droit à l’alimentation, avait qualifié de « crime contre l’humanité » la folie de la course vers les bio-carburants, en partie responsable de cette inflation. Les États-Unis avaient opté pour cette solution afin de régler leurs problèmes d’indépendance énergétique envers le Moyen-Orient. C’était aux heures les plus sombres de la guerre en Irak.
Mais voilà, pour de nombreux pays, par exemple la France et le Canada, il n’est pas question d’ouvrir le marché intérieur à des produits dont les normes environnementales, d’innocuité et de salubrité sont inférieures aux leurs. Pour Ottawa et Québec, ces légumes et fruits constitueraient une concurrence déloyale pour nos agriculteurs qui doivent assumer des coûts de production pour répondre aux meilleurs normes de qualité. Les pays émergents s’attaquent aux subventions directes, mais surtout aux mesures protectionnistes comme la gestion de l’offre. Cette politique oblige un producteur de lait ou d’œufs du Québec à posséder des quotas de production. Achetés à prix d’or, ces quotas lui permettent d’avoir un accès privilégié au marché local. Dans le but d’éviter que la concurrence représente une menace, une taxe de 155 à 299 % touche les produits régis par la gestion de l’offre qui proviennent de l’étranger.
Syndicat intégré
Le monopole syndical reste une des seules particularités du modèle québécois. Le rapport Pronovost est catégorique :
« Cette situation est malsaine et nuit à la crédibilité de l’UPA. Elle a tout intérêt à asseoir la légitimité de son mandat sur l’expression démocratique de ses membres. » La Commission a soulevé la colère du syndicat en décrétant que le gouvernement devait revoir la pertinence de son monopole. Même le gouvernement a reconnu que cette position dépassait son mandat. Selon l’Union paysanne, qui milite pour la pluralité associative, un syndicat ne peut pas bien représenter ses membres quand il est à la fois patron et législateur. « Le rapport Pronovost a créé un choc, mais la marche du progrès a déjà commencé », affirme son président, Benoît Girouard. Il cite en exemple la réforme de la gouvernance de la Financière agricole. Dorénavant c’est le gouvernement qui sera majoritaire à la table des décisions et non l’UPA, comme c’était le cas auparavant.
Rien n’est moins sûr pour Réjean Bessette, représentant de l’UPA de Saint-Hyacinthe. « L’UPA, c’est pour tout le monde », lance-t-il sans hésiter. Pour lui, il n’y a pas de distorsion démocratique. « Les fermiers, je les pèse pas pour savoir si je les défends. Qu’ils soient petits ou gros, ils peuvent avoir leurs opinions. On va les écouter puis on va voter. » Il est confiant que son organisation reste le seul syndicat. La population a bien plus à s’inquiéter des multinationales comme Monsanto. « On essaye de nourrir la population puis on se fait cracher dessus par les environnementalistes », s’exclame-t-il. La tendance des grosses entreprises à vouloir contrôler l’agriculture mondiale a été mise au jour notamment dans le documentaire Le monde selon Monsanto de Marie-Monique Robin. Dans plusieurs pays comme le Brésil et le Paraguay, les réformes agraires se sont traduites par l’augmentation substantielle du pouvoir des gros producteurs intégrateurs qui favorisent le marché international et les profits de la bourse plutôt que l’approvisionnement local. C’est un point sur lequel les deux antagonistes du monde rural s’entendent.
En Ontario, trois organisations se partagent la représentation du monde paysan. Même si l’UPA a décidé d’alléger sa structure en favorisant le regroupement des agriculteurs par secteur d’activité de production et en limitant à un représentant chaque municipalité régionale de comté (MRC), M. Bessette considère que le pluralisme syndical n’a pas sa place. « Si on compare, deux ou trois syndicats pour faire de la représentation avec les gouvernements, ça marche pas. On parle des deux côtés de la bouche. » Pour lui, le syndicat unique a toujours défendu l’intérêt des agriculteurs. Après les réformes de la Financière agricole, l’UPA a rencontré le gouvernement. Il était notamment question de la quantité totale d’hectares assurables pour les grandes cultures (maïs, soya, blé, orge, avoine). Le nouveau seuil fixait à 840 000 hectares la couverture maximale, une réduction de 30 000 hectares (équivalent de l’île Jésus et de l’île Perrot réunies). Après négociation, le gouvernement a rehaussé ce seuil à 865 000 hectares. « Dans les grandes cultures au Québec, on effleure l’autosuffisance, explique M. Bessette. J’ai jamais vécu d’aussi mauvais temps des Fêtes après les annonces sur les changements de la Financière agricole. Les gens pleuraient. » Selon lui, cet exemple illustre bien la pertinence et l’esprit « pratico pratique » de l’UPA.
Mais qu’est-ce que ça veut dire, la fin du monopole ? « C’est l’émergence de la paysannerie », soutien Benoît Girouard. Selon lui, l’UPA va éclater si le gouvernement décide d’ouvrir le monde syndical. « On n’est plus des urbains puis des granolas ». Selon son président, l’Union paysanne est prête et espère accueillir dans ses rangs 4 000 à 5 000 fermiers qui déserteront. Comme dans beaucoup d’autres pays, le monde paysan se divise en trois catégories : les gros producteurs, une certaine « classe moyenne » et les petits qui sont souvent divisés par secteurs d’activités. « On peut produire les sept millions de porcs, mais on peut le faire différemment. »
« Ça va se lever pis ben d’aplomb, avertit M. Bessette. Les agriculteurs n’accepteront pas. » Il demeure confiant sur l’avenir de son syndicat. C’est grâce à la Loi sur les producteurs agricoles de 1972 que l’UPA a été créée. Tous les agriculteurs ont l’obligation de cotiser même s’ils choisissent de ne pas en être membre. Les fermiers n’ont pu donner leur avis qu’une seule fois, en 1972, lors d’un référendum : celui de création du syndicat. C’est ce que demandait l’UP aux commissaires de la CAAAQ. En marge des dépôts de mémoires et des témoignages, les commissaires ont interrogé une centaine d’agriculteurs. « Ils ont répondu que le monopole ne les sert pas », affirme Benoît Girouard. Pour le représentant de Saint-Hyacinthe, c’est tout le contraire. « Diviser pour mieux régner, ça ne marche pas. » Selon lui, l’UPA est le mouvement syndical le plus apprécié. Un clin d’œil senti à la crise que traverse la FTQ construction. Deux solitudes que le gouvernement aura à contenter à travers ses réformes.