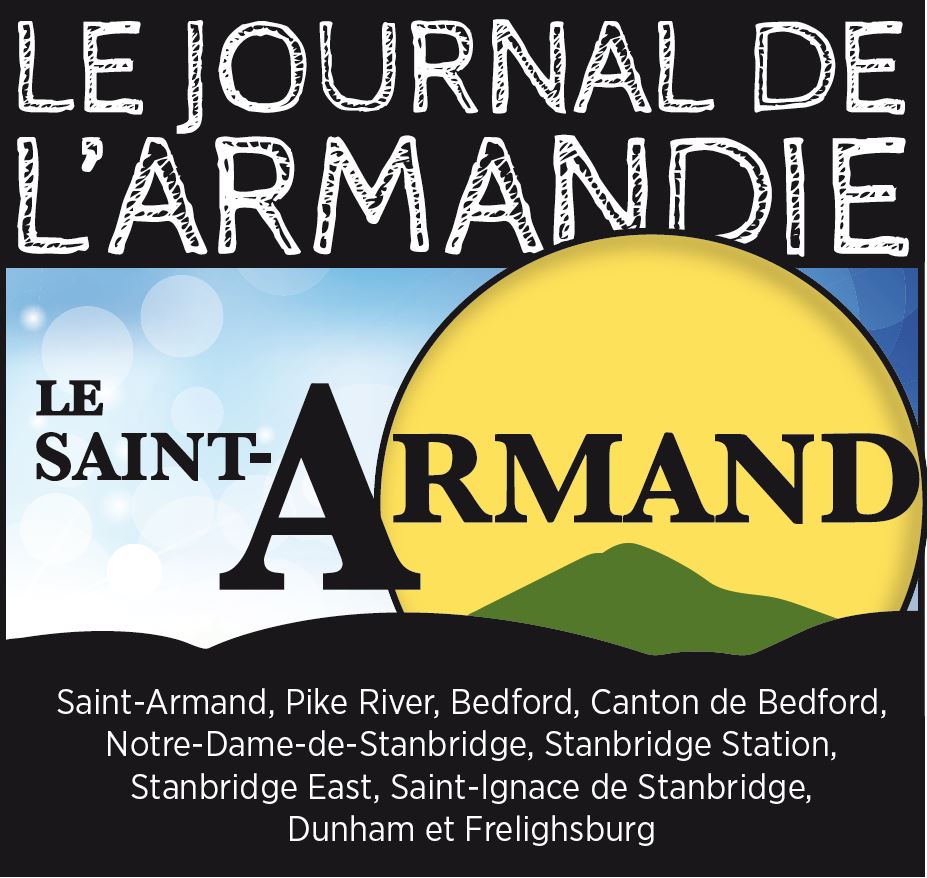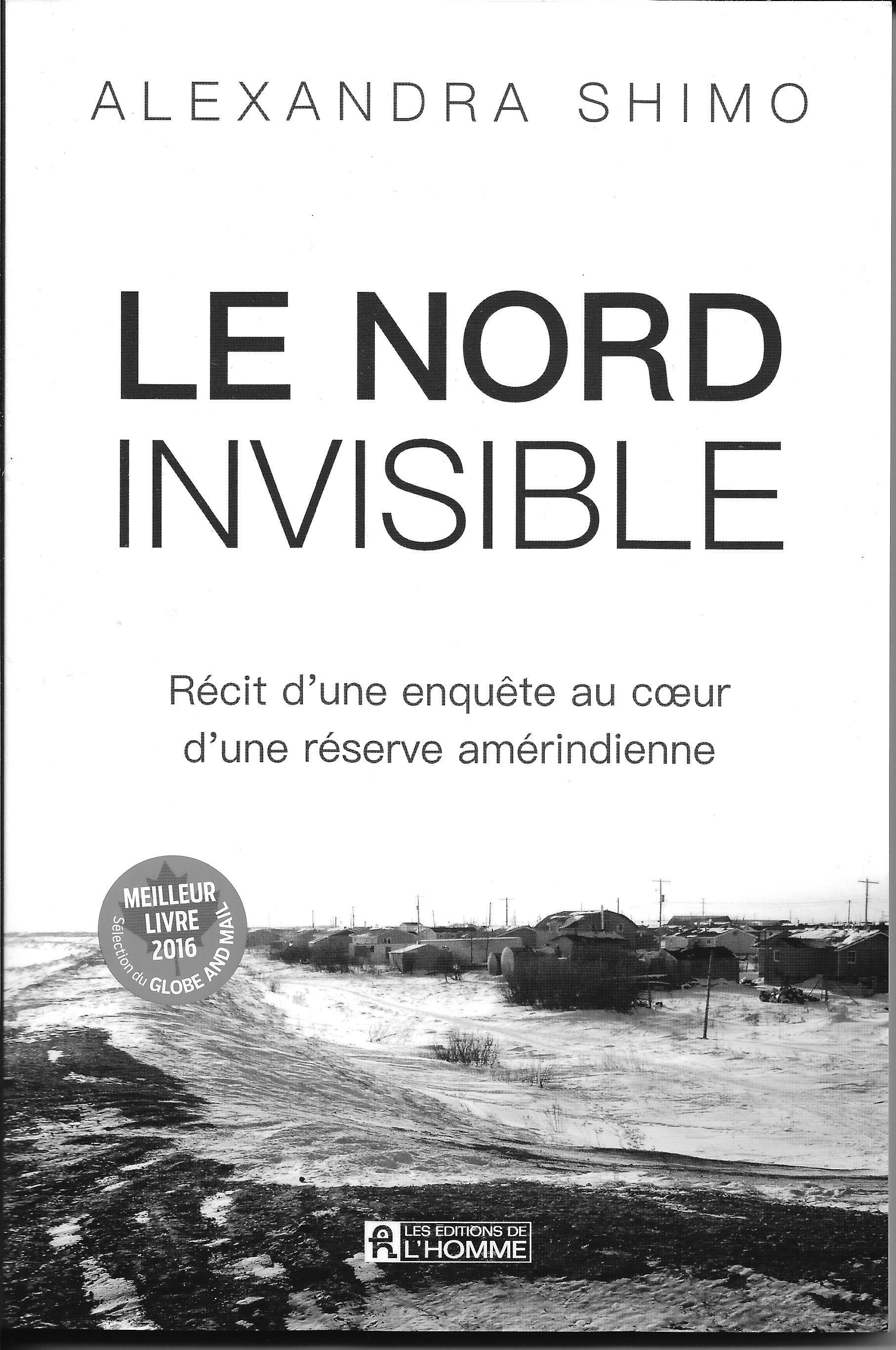Quand on m’a confié le mandat de traduire The Invisible North – The Search for Answers on a Troubled Reserve, j’avais entendu parler, comme bien d’autres, des conditions de vie déplorables qu’on retrouve dans de nombreuses communautés autochtones du nord canadien, mais la chose restait plus ou moins théorique, un sujet dont les journalistes parlent à l’occasion, qui fait la manchette un certain temps, puis dont il n’est ensuite plus question.
Cependant, ce livre est tout sauf un compte rendu détaché portant sur une vague communauté autochtone aux prises avec divers problèmes récurrents. C’est le témoignage d’une jeune journaliste pigiste de Toronto ayant décidé de passer cinq mois à Kashechewan, village cri situé sur la rive nord de la rivière Albany, qui se jette dans la baie James du côté ontarien. Son objectif : enquêter sur une crise de l’eau qui, selon les rumeurs, avait été montée de toutes pièces dans le but d’attirer l’attention du public et des autorités sur les conditions de vie dans la réserve.
Situé à plus de mille kilomètres de Toronto et accessible uniquement par avion, Kashechewan compte environ 1800 résidents qui se partagent quelque 280 habitations, toutes plus surpeuplées et déglinguées les unes que les autres.
Tout au long de ce récit, on a le sentiment de se trouver aux côtés de l’auteure : on emprunte en sa compagnie la rue principale du village où une fillette installée dans le fossé construit un château de sable avec du ciment en poudre, où dans une voiture abandonnée, une autre passe la tête à travers une vitre fendillée, son visage encadré de dangereux tessons de verre et où, la bouche fendue, une ado de 12 ans fait face à quatre garçons qui lui lancent des pierres. On l’accompagne au Northern Store où, à l’entrée, le gérant fouille les Autochtones mais par les Blancs, où la pomme de chou coûte 13$ et la douzaine d’œufs, 15$, et où l’on découvre que le Klik est la principale source de protéines avec le thon en boîte. Le revenu mensuel moyen oscillant autour de 390$, on ne peut se permettre autre chose. Comme elle, on aperçoit cette femme qui tire nerveusement sur la manche de son chemisier afin de cacher son éruption de teigne, maladie cutanée répandue dans la communauté pour cause de mauvaise hygiène.
Récits de tentatives de suicide ratées ou « réussies » par des ados, de pactes de suicide dont l’un impliquant 21 membres de la communauté, le plus jeune étant âgé de 9 ans, de ce jeune homme qui a failli mourir aux mains d’un père d’une extrême violence. Cuvettes de toilette débordant d’excréments, enfants qui dorment par terre en rotation parce qu’il manque de lits, fenêtres opaques parce que fermées de panneaux de contreplaqué, maisons couvertes de graffiti, tout cela, on le voit comme si on y était.
Il aura fallu six ans à Alexandra Shimo pour écrire The Invisible North. Six années où, à l’issue de son séjour à Kashechewan, elle a dû soigner un corps et un esprit gravement meurtris par l’expérience. Elle en était revenue anémique, alcoolique, déprimée et en état de choc post-traumatique. Voilà qui illustre parfaitement, selon elle, le fait que le problème ne vient pas des Autochtones eux-mêmes, mais bien des conditions de vie déplorables que leur impose la très désuète Loi sur les Indiens, à laquelle est assujettie toute leur existence – de la naissance à la mort. Et à laquelle, justement, Justin Trudeau prétend vouloir s’attaquer. Espérons que, contrairement aux nombreux autres qui ont entrepris cette démarche avant lui, il ne s’y cassera pas les dents.
Ce récit touchant est ponctué de nombreuses notes explicatives permettant de mieux comprendre la situation inextricable dans laquelle se retrouvent bien des petites communautés autochtones du nord canadien.
Le nord invisible – Récit d’une enquête au cœur d’une réserve amérindienne, Alexandra Shimo, Les éditions de l’homme, Montréal, 2017.