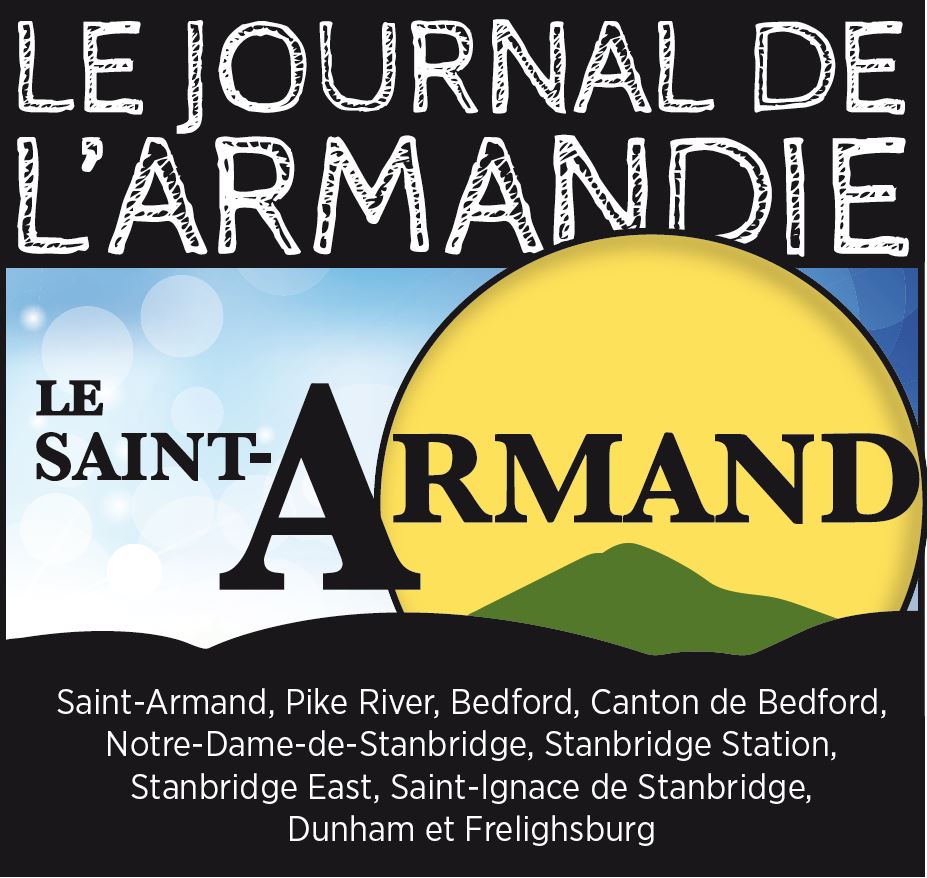Micheline Lanctôt (Photo : Bernard Carrière)
J’ai connu Micheline Lanctôt il y a 18 ans, lors de la naissance de la Fiducie foncière Mont Pinacle dont elle a été membre fondatrice. Comme tout le monde, je connais son immense talent devant et derrière l’écran. Elle dessine, joue de la musique, chante, écrit, joue la comédie, filme, dirige. Ce qu’on sait moins, c’est à quel point son histoire est intimement liée à notre coin de pays.
GK : Es-tu native de Frelighsburg (St-Armand-Est) ?
ML : Je suis née à l’hôpital à Montréal, mais mes parents habitaient Frelighsburg à temps plein. Mon père avait un verger. Mes racines profondes sont ici. J’y ai vécu de l’âge de quelques jours jusqu’à l’âge de cinq ans et après ça toutes les fins de semaine, tous les étés, toutes les vacances de Noël, tout le temps. Mon père a vendu son verger en 1976. On travaillait au verger. Il y avait un fermier qui s’en occupait.
Quels sont tes premiers souvenirs ?
Ici à Frelighsburg. J’ai le souvenir très précis de deux grandes peaux de vison que ma mère avait mises sur le plancher. C’était d’anciennes couvertures de carrioles, bordées d’un grand feutre vert. Il y en avait une dans la salle à manger et une dans le salon. J’adorais ça me coucher dessus, m’y vautrer, jouer avec les poils. Un souvenir, une sensation. On les as eues assez longtemps, jusqu’à ce que j’aie 10 ou 11 ans.
Des amis dans le coin ?
Il y avait la gang locale. On avait une voisine, Madame Bérubé, qui avait onze enfants. Il y en avait trois à peu près de mon âge. Celle qui était exactement de mon âge s’appelait Agnès. Adèle était un peu plus jeune et Odile un peu plus vieille. J’étais toujours avec Agnès. On se promenait nu-pieds partout, partout. Madame Bérubé faisait son pain, les gros pains fesses, les pains de ménage. Ma mère m’envoyait chercher du pain chez elle. Entre la maison de Madame Bérubé et celle de ma mère, je vidais le pain. Je faisais un petit trou et je mangeais toute la mie. Ma mère râlait et me renvoyait chercher d’autre pain.
En arrière de la maison, là où habitent les Panet-Raymond, il y avait Langis Thériault et sa famille. En face où Serge D’Amour reste, il y avait les Riopelle, dont Fernand qui a été mon premier soupirant, vers 10 ou 11 ans. On l’appelait « coque l’oeil » parce qu’il avait un oeil croche, mais il me trouvait bien de son goût.
Les terrains de jeux, c’était le ruisseau qui passait sous un ponceau. Agnès pis moi on allait chercher des écrevisses. On passait des heures et des heures et des heures à retourner les pierres et à ramasser des écrevisses. On les gardait dans des seaux ou on les relâchait. On les mangeait jamais.
La grande aventure, c’était d’explorer le ruisseau. La source en était pas très loin, chez Jean Bernier. En aval, il aboutissait dans un étang mystérieux, assez loin, —j’étais petite, ça me semblait bien loin — vers le village. C’était le gros défi. On partait nu-pieds dans le ruisseau et on était des explorateurs. Rendu à l’étang, là où le ruisseau se perdait, il y avait plein d’herbes coupantes et on s’était coupées d’une façon épouvantable, on avait des balafres, mais c’était l’exploit, un grand exploit. Agnès pis moi, on se faisait des concours de qui a la plante des pieds la plus solide. On s’endurcissait les pieds en se frottant la plante sur le gravier. C’était à qui pouvait faire ça le plus longtemps, sans que ça fasse mal. Celle qui avait le plus de corne en dessous était la meilleure.
C’est drôle parce que tous mes souvenirs d’enfance sont des sensations.
Le déménagement à Montréal a-t-il été difficile ?
Je n’ai pas de souvenir de ça. Ce qui a occulté ce retour, c’est l’entrée à l’école. Et j’aimais tellement ça. J’aimais apprendre. Les livres étaient des dictionnaires, des encyclopédies. J’étais très curieuse. Il paraît — c’est ma mère qui m’a dit ça, moi je n’ai aucun souvenir —qu’avant que j’aie l’âge scolaire, je suivais ma sœur à l’école et je me cachais sous le pupitre de la maîtresse pour écouter la classe.
Tu es allée à l’école jusqu’à quand ?
L’école, le couvent, le collège, puis l’Université de Montréal. J’ai fait un an en histoire de l’art. Ça a été mon gros max. Je ne pouvais plus. Ce qui était intéressant en histoire de l’art, c’est qu’on avait des travaux pratiques le samedi. On allait au Musée des beaux-arts, puis on faisait des vraies affaires. Après cette année, j’ai dit à mon père que je voulais entrer aux Beaux-Arts parce que je n’étais pas du tout une théoricienne. J’étais pas faite pour ça. Étudier des morceaux d’église gothique, étudier des tessons de céramique ionienne, ça me rendait folle. J’avais quelques cours intéressants, mais pour le reste, c’était vraiment ennuyant comme la pluie. J’avais un professeur d’art contemporain qui était extraordinaire. Il nous a vraiment initiés à Duchamp, à tout un volet de l’art, le dadaïsme, le surréalisme, le début du cubisme, du fauvisme. Il était fascinant.
Tu as commencé à peindre à ce moment-là ?
Non, je dessinais depuis longtemps. J’avais pris des cours de dessin au Mont-Jésus-Marie, depuis l’âge de 9 ou 10 ans. Je faisais beaucoup de dessins en classe au lieu d’écouter les cours. Après l’année en histoire de l’art, j’ai fait mon inscription aux Beaux-Arts et j’ai été acceptée. J’ai lâché après deux mois. Je ne supportais pas. C’était archi-académique. Mais comme j’avais beaucoup dessiné et que j’essayais toutes sortes d’affaires, je n’étais pas capable de me plier à ce qui était demandé, à leurs bases que je trouvais absurdes. Y’a un professeur qui m’avait mis zéro parce qu’elle nous faisait faire des natures mortes au fusain puis comme ça m’emmerdait beaucoup —une table à carreaux, puis une théière, des bébelles, je trouvais ça ben plate —alors j’avais aplati ma nature morte de façon contemporaine. J’avais fait un Fauve de moi-même. Elle aurait pu me reconnaître au moins l’originalité de la facture. Un autre professeur m’avait dit qu’on ne pouvait pas mettre du bleu à côté du rouge. J’avais trouvé ça tellement idiot, tellement stupide.
Il y avait quelques cours que j’aimais. J’étais très douée pour ce qu’on appelait la géométrale. Le dessin en trois dimensions. J’étais pas mal plus proche de la sculpture que j’étais proche du dessin. Le professeur, j’étais son chouchou. Il me faisait faire des affaires compliquées comme des pieuvres à l’acrylique. Je dessinais tous les angles, j’aimais beaucoup ça, ce genre de dessin d’observation. J’avais un cours de sculpture que j’aimais beaucoup aussi. Mais le reste, pffff. Après deux mois j’ai décroché.
Où étais-tu quand JFK a été assassiné, au mois de novembre 1963 ?
J’étais au collège, dans la classe. Je m’en souviens très bien. On était en examen. En sortant de la salœ d’examen, les sœurs nous avaient dit ça et ça avait été une stupéfaction générale. Pleurs, cris. En rentrant chez nous, je m’étais assise au piano et j’avais joué la marche funèbre de l’andante de la septième symphonie de Beethoven. Avec cœur.
Est-ce qu’il y a d’autres dates d’événements collectifs qui t’ont marqués ?
Les événements d’octobre 1970 ont été extrêmement marquants. Je travaillais au centre-ville, en animation chez Potterton Productions, à la Place Bonaventure. C’était un studio d’animation privé. J’y ai travaillé cinq ans. J’avais une collègue du paint and trace qui était d’origine haïtienne et qui s’était fait arrêter. Elle nous avait raconté que le soldat lui avait pointé sa mitraillette dans la face. On avait bien ri, car en animation on rit de tout. De façon sardonique si possible. Mais moi je m’appelais Lanctôt, donc j’étais sous surveillance. Toute ma famille était sous surveillance. Et en plus j’habitais une maison qu’on se partageait à deux avec un grand ami écrivain qui était très proche de certaines cellules felquistes. Mon oncle Raymond Lanctôt s’est fait défoncer par la GRC à trois heures du matin dans sa ferme à Havelock.
Après ces événements, il y a eu l’élection du PQ en 1976. J’étais partie vivre en Californie en 73, mais j’étais revenue pour voter. Un moment absolument extraordinaire. Je me souviens en particulier du village de Saint-Denis, un village qui avait beaucoup souffert dans le passé car c’était le village des patriotes de 1837 et les Anglais l’avaient beaucoup puni. En 76, le comté a gagné ses élections. Par la suite, j’y ai vécu 13 ans.
Comment as-tu commencé à travailler comme actrice ?
En 1972, je travaillais en animation et Gilles Carle m’a demandé de passer un screen test. J’avais déjà fait du théâtre au collège et du théâtre amateur. J’ai décroché le rôle-titre dans La vraie nature de Bernadette. Ma vie a bifurqué. Ça a coïncidé avec le fait que j’étais plafonnée en animation parce que c’est un milieu qui n’était pas fait pour les femmes. Encore. Mes collègues masculins faisaient cinq fois mon salaire. Ça m’aurait pris encore 15 ans pour arriver à un stade intéressant où tu es à l’origine du mouvement plutôt que d’en être l’exécutant.
C’est une période où je ne venais pas souvent à Frelighsburg, mais je ne pouvais m’habituer à vivre en ville.
Quand as-tu choisi de t’installer dans la région ?
J’ai acheté à Frelighsburg en 1986. Une maison avec 25 acres. Je ne voulais pas avoir de voisins, alors j’ai achalé les voisins jusqu’à ce qu’ils se décident à vendre et j’ai acheté une quarantaine d’acres de plus. Venant de Montréal, je suis une transplantée, mais mes racines à moi sont ici.
Je suis hybride. C’est ici que je reviens tout le temps. Je ne pourrais pas ne pas vivre ici. C’est mon point d’attache. Je ne pourrais vivre dans des endroits plus touristiques. Ici, c’est la configuration idéale pour moi. Villégiature, mais pas trop. Agricole, mais pas trop. Proche de Montréal, mais pas trop de monde. Vocation culturelle de la région. Proximité des États-Unis. Bien ou mal.
Je suis indissociable du lieu.
Merci, Micheline.