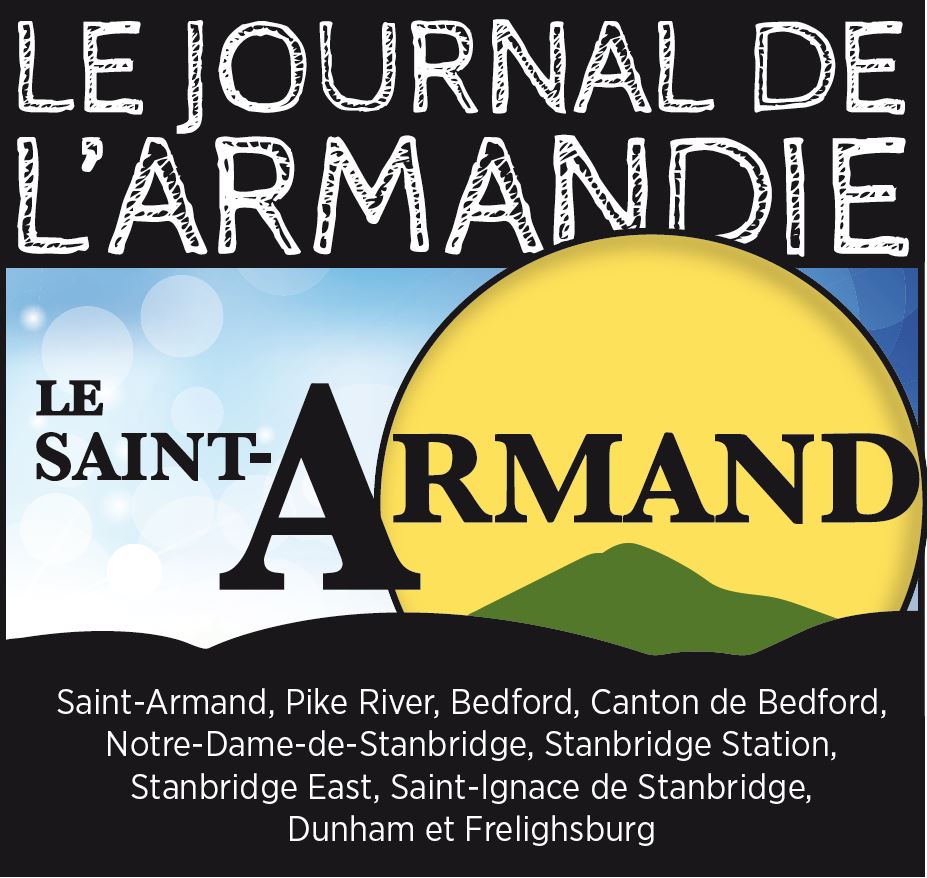Le financement du système de santé québécois nous coûte, collectivement, plus de 30 milliards de dollars par année, sur un budget global de plus de 71 milliards pour l’ensemble des dépenses publiques provinciales.
 C’est dire qu’un peu plus de 42 % des taxes et impôts que nous payons à Québec servent à couvrir les coûts de notre système public de santé : salaires et honoraires des professionnels de la santé, médicaments couverts par le système de santé, hôpitaux et centres de soins, administration, etc. Et cela ne tient pas compte des dépenses encourues par chacun de nous pour des soins de santé qui ne bénéficient pas de la couverture dite « universelle » de la carte-soleil.
C’est dire qu’un peu plus de 42 % des taxes et impôts que nous payons à Québec servent à couvrir les coûts de notre système public de santé : salaires et honoraires des professionnels de la santé, médicaments couverts par le système de santé, hôpitaux et centres de soins, administration, etc. Et cela ne tient pas compte des dépenses encourues par chacun de nous pour des soins de santé qui ne bénéficient pas de la couverture dite « universelle » de la carte-soleil.
Dans les faits, ces quelque 30 milliards de dollars ne suffisent pas à payer ce qui est couvert par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). On l’a dit et répété sur tous les tons : la couverture de la RAMQ est tout sauf universelle, les urgences débordent et ne suffisent pas à la tâche, il manque de médecins pour répondre aux besoins de tous les Québécois et les listes d’attente pour certains soins de santé sont interminables. Il faudrait donc, en toute logique, trouver davantage de sous pour financer le tout.
C’est pourquoi l’ancien gouvernement avait instauré la très contestée contribution santé qui, d’après les prévisions des libéraux, devait injecter
1 milliard de plus dans les budgets en 2012 et près de 1,5 milliard en 2013, tout en laissant encore, en 2014, un manque à pourvoir d’au moins 430 millions.
Mais il ne faudrait pas penser que nous nous en tirons plus mal qu’ailleurs en ces matières : toutes proportions gardées, on observe le même phénomène dans les autres provinces canadiennes et en Europe ; et c’est bien pire aux États-Unis où, bien souvent, seuls les bien nantis ont accès aux soins de santé que l’on considère ici comme minimaux. L’explosion des coûts dans le domaine de la santé est donc bel et bien généralisée, à l’échelle de la planète.
Qu’est-ce donc qui coûte aussi cher ?
Au cours des dernières décennies, le coût des médicaments et le nombre des ordonnances médicales ont connu des hausses vertigineuses. Entre 2003 et 2010, le gouvernement sortant a accepté d’augmenter de 2 milliards la rémunération de quelque 20 000 médecins (une augmentation globale de 60 % du budget consacré à leur rémunération), sans toutefois réussir à en augmenter suffisamment le nombre : au ministère de la Santé et des Services sociaux, de même qu’au syndicat des médecins de famille, on estime qu’il manque encore, actuellement, quelque 1100 médecins de médecine générale pour répondre aux besoins des Québécois. C’est pourquoi de plus en plus de voix s’élèvent pour souligner l’urgence de procéder à une réflexion sérieuse sur le coût et la consommation de médicaments, de même qu’à une révision de la rémunération des médecins.
Pour plusieurs, cela mène à remettre en question le principe selon lequel tout citoyen a droit à une couverture de base en matière de santé. On est alors tenté d’ouvrir la porte à la logique du privé dans le système public : tarification à l’acte, régimes d’assurance privés, cliniques privées, etc. Mais il est clair que cela ne réglerait rien : là où on a tenté de donner davantage de place à cette logique du privé, en Suède et en Grande-Bretagne par exemple, on constate que ce mode de financement exige une lourde structure administrative, engendre du surdiagnostic, des traitements inutiles ou discutables, et a été un relatif échec, selon une note socio-économique publiée en juin 2012 par l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), et signée par nul autre que notre actuel ministre de la Santé, le Dr Réjean Hébert.
Dans un système de santé plus privatisé, les riches dépenseraient davantage en services médicaux divers, mais l’écart entre eux et les moins bien nantis continuerait de croître. Et il est probable que la santé des uns et des autres ne serait pas pour autant améliorée. Parce que les principaux déterminants de la santé ne se trouvent pas dans la quantité de médicaments consommés, dans le nombre de tests diagnostiques administrés ou dans la quantité de médecins qui exercent. Ces déterminants de la santé sont très bien connus et identifiés, et ils ont plutôt à voir avec l’alimentation, le logement, le revenu, les habitudes de vie, l’environnement et l’éducation. Voilà les choses qui ont le plus d’influence sur la santé. Voilà ce dont il faudrait nous occuper au premier chef pour améliorer l’état de santé de la population. On le sait depuis plusieurs décennies de manière certaine, et c’est clairement démontré.
 Il est clair que, tant que nous négligerons de nous occuper sérieusement de ces déterminants de la santé, pour allouer toutes les ressources disponibles à des choses qui n’ont qu’un impact relatif sur la santé de la population, nous ferons du surplace et nous risquons même d’aggraver encore davantage la situation.
Il est clair que, tant que nous négligerons de nous occuper sérieusement de ces déterminants de la santé, pour allouer toutes les ressources disponibles à des choses qui n’ont qu’un impact relatif sur la santé de la population, nous ferons du surplace et nous risquons même d’aggraver encore davantage la situation.
Que faire alors ?
Le professeur Didier Truchot, maître de conférences en psychologie sociale à l’Université de Franche-Comté, actuellement en visite à l’Université du Québec en Outaouais, déplore la réaction des gouvernements qui, selon lui, tendent à privatiser davantage la santé au lieu d’embaucher plus de personnel infirmier. Il estime que cette solution ne fait que creuser le fossé entre les riches et les pauvres, sans vraiment désengorger le système. « Ça va mal dans les hôpitaux, dit-il. On manque d’effectifs et le personnel croule sous la charge de travail. Ça crée des tensions. Le personnel infirmier devient plus irritable et la situation ne fait que se dégrader encore plus ». Il estime que la situation n’est guère mieux chez les médecins généralistes, qui sont eux aussi sur la liste rouge des professionnels à risque de burnout. « Ils ont le sentiment de perdre leur statut social. Leurs relations avec leurs patients se sont beaucoup compliquées. Aujourd’hui, les médecins n’ont plus la vérité absolue. Les patients vont sur Internet et font leurs propres diagnostics », dit-il. Bref, il met le doigt sur le fait que la médecine moderne a peut-être trop misé sur la spécialisation médicale au détriment de la médecine de première ligne, qui était traditionnellement assumée par des médecins plus dévoués au service des patients qu’à l’exercice d’une pratique florissante et lucrative.
Pour agir sur les véritables déterminants de la santé, il faudrait également faire appel à d’autres travailleurs : nutritionnistes, thérapeutes formés à diverses approches éprouvées, travailleurs sociaux, éducateurs, etc. Bref, il faudrait que la santé soit envisagée de manière globale et décloisonnée et que les bénéficiaires soient remis au centre de toutes les interventions, les travailleurs de la santé se plaçant à leur service.
Tous ces services pourraient-ils être couverts par le régime d’assurance maladie ? Probablement pas, mais une telle approche aurait pour effet, à moyen terme, d’améliorer l’état de santé général dans la population et, par conséquent, de diminuer significativement les coûts du système actuel ou, pour le moins, de contribuer à en contenir la croissance effrénée que nous lui connaissons.
Une fois tout considéré, il importe de maintenir un système de santé de première ligne qui soit accessible au plus grand nombre, dans le milieu immédiat où chacun mène sa vie. Mais il importe que les services qu’il offre ne soient pas seulement axés sur une médecine spécialisée et cloisonnée qui tend à ne privilégier que les solutions médicamenteuses et une panoplie d’interventions médicales qui, tout compte fait, bien qu’elles soient fort utiles et souvent essentielles, ne sont pas nécessairement les principaux déterminants de la santé.
Les conditions du succès
Pour que cela fonctionne rondement, il faut que trois conditions soient réunies. En premier lieu, la communauté doit se mobiliser et une masse critique de citoyens concernés doit travailler au maintien et à l’amélioration des services de proximité en matière de soins de santé et de prévention de la maladie. Ensuite, différents travailleurs de la santé doivent accepter de travailler ensemble, dans un esprit de service à la population, par delà les intérêts corporatistes et professionnels. Finalement, il faudra que le gouvernement dissipe un certain nombre de malentendus en clarifiant les politiques à l’égard de ce qui est couvert par la RAMQ et de ce qui ne l’est pas, sans se prendre les pieds dans la dichotomie idéologique entre la « couverture publique universelle » et le « tout au privé ». Il sera notamment nécessaire de baliser adéquatement le fonctionnement des coopératives de santé. Ces dernières pourraient très bien représenter une solution concrète pour mettre en place des services de santé suivant une formule mixte (public/privé) sans pour autant ouvrir la porte à une domination indue de la part de l’industrie ou des corporations professionnelles.