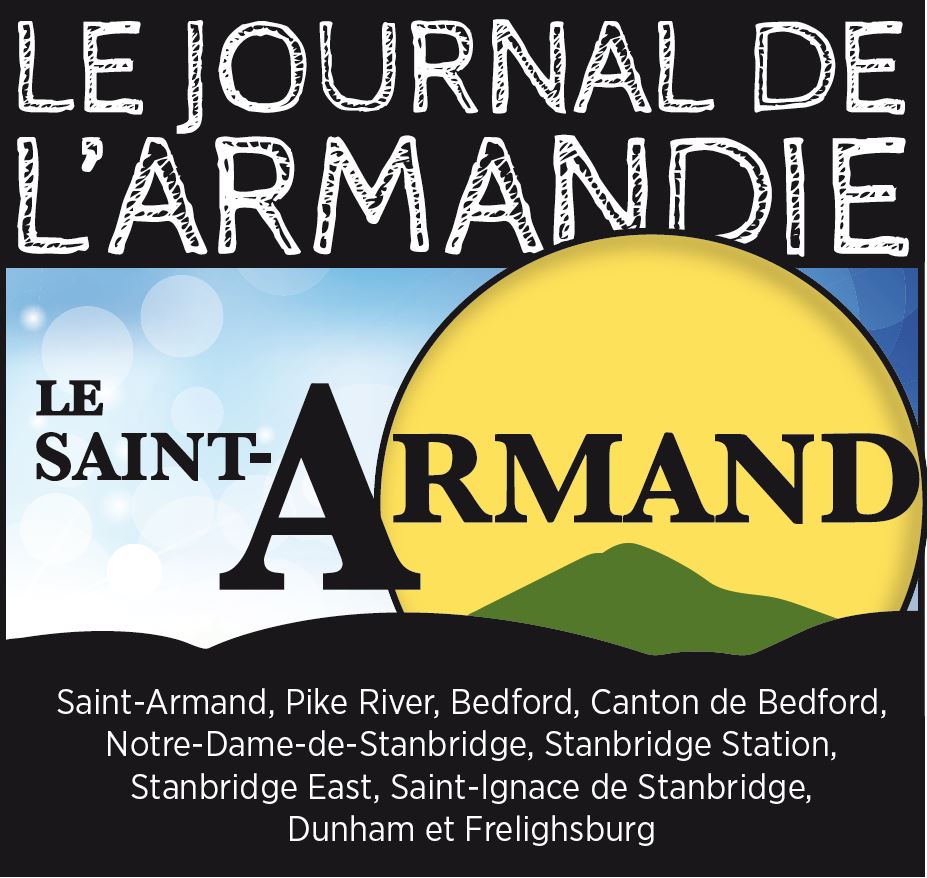Chers lecteurs et chères lectrices, il y a un bon moment déjà que je souhaite vous raconter le parcours d’une personne demandant l’asile au Canada. On le sait, une telle personne arrive sans permis ou visa et sollicite la protection du gouvernement car sa vie est menacée dans son pays d’origine. Souvent, elle a traversé des continents et a dû faire face à d’immenses obstacles et difficultés avant d’arriver enfin en terre canadienne. Une fois sur place, elle commence à travailler en attendant le jour où elle passera devant un juge. C’est ce magistrat qui décidera de son destin.
Souvent craintifs, les demandeurs d’asile préfèrent généralement s’abstenir de raconter leur histoire. Leret Fataki fait exception à cette règle. Je la remercie d’avoir accepté de partager son vécu avec vous et avec moi. À travers son propos, je souhaite donner la parole à ceux qui, comme elle, ont tout perdu et ont tout laissé derrière eux. Qui arrivent ici avec l’espoir pour seul bagage.
Aujourd’hui âgée de 44 ans, Leret Fataki travaille désormais comme préposée aux bénéficiaires dans une résidence pour aînés de Cowansville. Arrivée au pays le 30 novembre 2021 par le chemin Roxham, aujourd’hui fermé, elle a décidé de s’installer ici en attendant de passer devant le juge qui décidera de son sort : lui accorder le statut de résidente permanente ou la déporter.
Originaire de la République Démocratique du Congo (RDC), cette mère de quatre enfants a dû laisser ceux-ci là-bas sous la garde de sa mère et de sa sœur. En effet, il y a quatre ans, elle a dû quitter le pays à la suite d’une attaque menée contre son conjoint et contre elle. Lui a perdu la vie, mais elle a survécu et s’est réfugiée en Angola, le pays voisin. « Mon pays est riche, m’a-t-elle confié, mais nous sommes tellement pauvres. Je travaillais en tant qu’institutrice dans une école primaire, mais mon salaire était misérable. Mon époux et moi avons décidé de nous impliquer en politique, mais les rivalités tribales étant courantes en RDC, notre candidat à la présidence n’a pas été élu et l’on a voulu nous tuer. »
En Angola, elle apprend le portugais dans le but d’y rester le temps que le gouvernement du Congo change, espère-t-elle, et qu’elle puisse retourner chez elle. Cependant, les Congolais ayant immigré en grand nombre dans ce pays voisin à l’occasion des nombreuses guerres intestines qui ont marqué leur histoire, le gouvernement angolais n’était pas disposé à en accueillir davantage et cherchait plutôt à les retourner chez eux. À l’instar de nombre de ses compatriotes, Leret Fataki se rendra donc au Brésil, autre pays lusophone, munie du passeport angolais qu’elle s’est procurée entre-temps. « Au Congo, avoir un passeport c’est un luxe, m’a-t-elle expliqué. La plupart des gens n’en n’ont pas, car ou bien tu manges ou bien tu en as un. »
Arrivée à Rio de Janeiro, elle trouve à se loger dans la favéla de Jacarezinho, un des quartiers noirs défavorisés de la métropole. Pour survivre, elle doit se résoudre à vendre dans la rue divers objets, parapluies, chapeaux, bref, n’importe quoi pour lui permettre de manger. Cependant, elle confie ne s’être jamais sentie comme une étrangère à Rio. À ses yeux, c’était comme l’Afrique.
Elle y était le 6 mai 2021 quand une opération policière, qualifiée de massacre par Amnesty International, a fait plus de vingt-cinq morts dans son quartier. Effrayée, elle prendra la route à pied avec d’autres habitants de Jacarezinho dans le but de se rendre à la frontière entre le Brésil, la Colombie et le Pérou.
Chaque jour, des milliers de migrants prennent ce dangereux chemin et traversent la jungle amazonienne afin de se rendre dans les forêts tropicales du Darién, où ils doivent emprunter un passage réputé être parmi les plus dangereux du monde.
Leret Fataki évoque ce moment très particulier où elle s’apprêtait à monter dans la petite embarcation qui devait l’amener en Colombie par le fleuve Amazone : « J’ai pensé à mes enfants et à tous les gens que j’ai connus qui sont décédés sur cette route. J’ai décidé de retourner et je suis rentrée à Rio, déterminée à trouver une autre solution pour me rendre au Canada » ajoutant que, pour des milliers d’autres dans sa situation, le Canada est le seul endroit sûr dans les Amériques.
À l’ambassade du Mexique de Sao Polo, elle obtient un visa touristique de deux mois pour Mexico. Puis, à l’automne 2021, elle tente, comme bien d’autres avant elle, la traversée du Rio Bravo (ou Rio Grande, fleuve qui marque la frontière entre le Mexique et les États-Unis) dont les eaux traîtresses ont déjà emporté beaucoup de vies. Elle n’a pour toute possession que les vêtements qu’elle porte sur elle et son cellulaire, fixé à sa tête à l’aide d’un bandana afin d’éviter de le mouiller, l’eau lui arrivant jusqu’au cou.
Aux États-Unis, elle est détenue dans un centre de rétention. Comme elle a perdu son passeport angolais dans les eaux profondes du Rio Bravo, on a rapidement programmé une rencontre avec un juge. « Je savais qu’on voulait me déporter, confie-t-elle, et je me suis dit que je devrais franchir la frontière canadienne avant la date de mon audience, prévue pour le 6 janvier 2022. Mais les frontières étaient fermées à cause de la pandémie. On priait tous très fort pour qu’elles soient rouvertes. » Dans l’attente de ce moment tant espéré, elle est logée dans une auberge de Portland réservée aux migrants. Au moment de partir, on lui fournira nourriture, vêtements et conseils pour la traversée de la frontière.
Le 30 novembre 2021, soit précisément 9 jours après la réouverture des frontières, elle emprunte le chemin Roxham. Comme elle n’a pour toute pièce d’identité qu’une copie de sa carte d’électrice congolaise, on la gardera une semaine à Lacolle où elle passera diverses audiences avant qu’on la laisse finalement entrer au pays. Le 9 décembre, elle débarque au YMCA de Montréal et entreprend alors une formation de préposée aux bénéficiaires d’une durée de deux mois. « C’est une façon de gagner sa vie, mais aussi d’aider les autres et je voulais aider, explique-t-elle. Les bénévoles des centres pour les aînés m’ont beaucoup aidée. Je ne vais jamais oublier cela et je me suis dit que, dès que je serais installée, moi aussi j’allais devenir bénévole et aider les autres, comme on l’a fait pour moi. »
 À Montréal, elle sera embauchée par une agence de placement et travaillera dans divers centres pour aînés. En quête d’un emploi stable, elle entend parler d’un poste ouvert à Cowansville et c’est ainsi que, en avril dernier, elle arrive dans la région. Lors de sa première journée de congé, alors qu’elle explore sa nouvelle ville, une parfaite inconnue se présente à elle : « Moi je m’appelle Marielle, et toi ? » C’est ainsi que nait une amitié, la Marielle en question s’étant empressée de lui faire découvrir la ville et de lui faire connaître, par la même occasion, le Centre d’action bénévole. « J’étais heureuse d’apprendre qu’il y avait une banque alimentaire, j’en ai eu besoin pour un peu de temps seulement. Ensuite, j’ai donné mon nom pour devenir bénévole et donner à mon tour un coup de main. »
À Montréal, elle sera embauchée par une agence de placement et travaillera dans divers centres pour aînés. En quête d’un emploi stable, elle entend parler d’un poste ouvert à Cowansville et c’est ainsi que, en avril dernier, elle arrive dans la région. Lors de sa première journée de congé, alors qu’elle explore sa nouvelle ville, une parfaite inconnue se présente à elle : « Moi je m’appelle Marielle, et toi ? » C’est ainsi que nait une amitié, la Marielle en question s’étant empressée de lui faire découvrir la ville et de lui faire connaître, par la même occasion, le Centre d’action bénévole. « J’étais heureuse d’apprendre qu’il y avait une banque alimentaire, j’en ai eu besoin pour un peu de temps seulement. Ensuite, j’ai donné mon nom pour devenir bénévole et donner à mon tour un coup de main. »
Chaque fois que possible, Leret Fataki communique avec ses enfants âgés respectivement de 18, 16, 14 et 8 ans, qui lui demandent invariablement quand ils pourront la revoir et quand ils seront enfin réunis à nouveau. Elle attend désespérément le jour de son audience, le jour de sa vie. « Je ne suis pas capable de dormir et à chaque fois que je reçois une correspondance du ministère de l’immigration mon estomac veut exploser. Les gens n’imaginent pas ce que c’est que d’être un demandeur d’asile. »